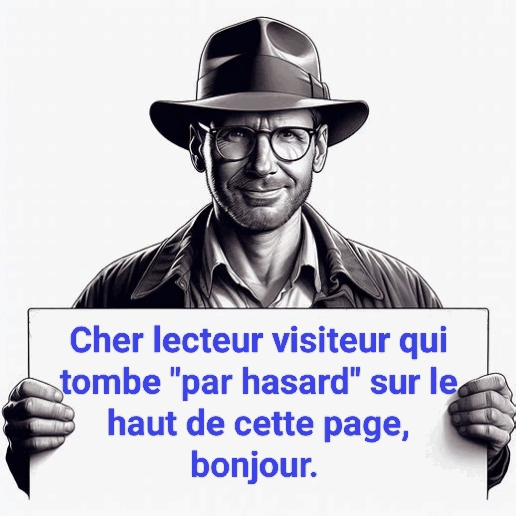J'm'interroge a écrit : ↑01 déc.24, 01:11
Quel que soit le niveau de langage, nous ne sommes pas le Tout, ni le Grand tout, ni tout.
Le maintenir, quel que soit le niveau de langage où c'est maintenu, est une erreur qui induit en erreur.
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
Tu as totalement le droit de le croire.

Je n'ai pas à le croire, puisque je le sais. Ni toi ni moi ne sommes le Tout, ni le Grand tout, ni tout.
Croire être le Tout, le Grand tout ou tout est juste aberrant, et il est aisé de comprendre en quoi c'est une erreur.
Cela t'a d'ailleurs déjà été très bien expliqué, à plusieurs reprises et par d'autres que moi également.
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
Tu ne sauras que ce que je dis est véridique seulement le jour où tu en feras toi-même l'expérience vivante, intime, profonde et permanente.
Tu dis ça, comme si toi tu en faisais l'expérience, alors que ce n'est qu'une croyance que tu entretiens parmi d'autres auxquelles tu t'accroches, et que tu prends pour des réalités.
Se déclarer être sans croyance peut aussi en constituer une, qui se rajoute à d'autres ignorées.
J'm'interroge a écrit : ↑01 déc.24, 01:11
Tu dis qu'il n'y a personne pour se rendre compte de quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément vrai non plus.
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
C'est vrai dans le référentiel No3, mais pas forcément dans les autres.
Evoquer "tes niveaux de langage" ou de tes "référentiels" en donnant un numéro, sans préciser de quoi il s'agit, n'est rien d'autre qu'un subterfuge conscient ou inconscient l'ami.
Sans préciser de quoi il s'agit ton discours est INCOHERENT.
Pour qu'il soit COHERENT, soit tu cesses de te contredire, soit tu précises à chaque fois en quoi telle ou telle affirmation que tu fais serait vraie selon toi.
C'est pas compliqué.
Sinon ce n'est qu'une manière de dire tout et son contraire, en espérant échapper à toute critique.
J'm'interroge a écrit : ↑01 déc.24, 01:11
Il y a bien une capacité de se rendre compte de ce dont on se rend compte. Cette capacité existe, et est bien individuelle, personnelle l'on peut dire. Toi-même tu ne peux que le reconnaître, puisque tu déclares souvent que certains "ne seraient pas conscients" de "Ce" qu'ils sont réellement.
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
Capacité il y a, oui, bien sûr, mais elle n'est pas "personnelle".
C'est là que ça coince, chez toi.
J'aurais plutôt dit que c'est là où ça coince dans ton système de croyances personnelles gzabirji.
En quoi cette capacité de nous rendre compte de ce dont nous nous rendons compte ne serait-elle pas personnelle, du moins individuelle, du moment qu'elle est propre à nous et qu'elle diffère d'un individu à l'autres ?
Nierais-tu aussi l'existence des autres ?
Comme je l'ai dit : ton erreur est de conclure sans raison qu'elle ne le serait pas. Déclarer qu'elle serait impersonnelle ou non individuelle repose sur un biais de croyance.
Et tu n'as pas répondu au fait que toi-même tu devrais le reconnaître, puisque tu déclares souvent que certains "ne seraient pas conscients" de "Ce" qu'ils sont réellement..
>>>>> Comment serait-ce possible si cette faculté n'était pas individuelle ?
Essaye de répondre honnêtement à cette question pour une fois.
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
Tu as une façon de t'exprimer qui n'est pas claire.
Ce que je dis est très clair, c'est dans ton esprit que c'est confus.
J'm'interroge a écrit : ↑01 déc.24, 01:11
Il y a bien "quelque chose" qui ne se réduit pas à une construction mentale (imaginale ou notionnelle) ou intellectuelle (conceptuelle ou théorique), un "quelque chose" qui comprend, qui perçoit, ressent et a ces constructions (imaginales ou notionnelles) ou intellectuelles (conceptuelles ou théoriques).
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
En effet, et c'est justement Ce que Nous Sommes réellement.

Et Ce n'est pas "personnel".
Mais non. C'est simplement ce que tu crois. Contrairement à ce que tu affirmes, ce que nous sommes réellement est tout à fait personnel dans le sens que c'est bien individuel. En effet, ta capacité de te rendre compte de ce dont tu te rends compte, est propre à toi, ce n'est pas la même d'un individu à l'autre. Donc, non dualité oblige, c'est bien d'une capacité personnelle ou individuelle dont il s'agit, même si effectivement, je suis d'accord avec toi là dessus : nous ne sommes pas le personnage défini comme ce que nous nous représentons de nous-mêmes, lequel n'est évidemment qu'un ensemble de constructions mentales (imaginales ou notionnelles) ou intellectuelles (conceptuelles ou théoriques), comme je l'affirme moi-même.
Ma critique porte sur le fait que tu conclus un peu trop rapidement à cette im-personnalité, alors que tu n'as absolument aucun élément de preuve dans ce sens, mais seulement des croyances toutes faites. Et ne reviens pas avec cette prétention gratuite que tu expérimenterais le fait que cette capacité de nous rendre compte de ce dont nous nous rendons compte ne serait pas individuelle, car d'un : je ne vois pas comment tu pourrais l'expérimenter, et de deux : tu te contredirais, puisque tu affirmes par ailleurs, comme nous l'avons vu, que certains "ne seraient pas conscients" de "Ce" qu'ils sont réellement, alors que d'autres si. Comment expliquer cette incohérence ?
J'm'interroge a écrit : ↑01 déc.24, 01:11
Et le déclarer impersonnel ou non individuel, c'est aller un peut vite en interprétations.
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
C'est simplement exprimer avec des mots Ce que Nous Sommes au plus intime de Nous-même.
Nous vivons cette impersonnalité, et c'est pourquoi nous en témoignons.
Non, comme je viens de l'expliquer, tu n'expérimentes pas cette impersonnalité. Tu la conjectures sur une base de croyances et dans une certaine incohérence logique comme je l'ai montré.
Nous ne nous vivons pas comme des entités impersonnelles. Nous pouvons y croire certes, mais cela ne constitue pas une expérience.
C'est comme avec la soi disant expérience de la permanence, il ne s'agit pas en réalité dune expérience, ce n'est qu'une simple croyance que personnellement, je ne partage pas avec toi.
Je sais, ce n'est pas forcément évident à comprendre, pourtant c'est bien le cas.
J'm'interroge a écrit : ↑01 déc.24, 01:11
Je ne parlais pas de la méthode du "neti-neti", je connais son bien fondé.
Il était question des propos erronés comme
"je suis le Tout, le Grand tout ou le tout" ou
"il y a un support aux perceptions qui est inaffecté par ces dernières".
En quoi ce serait des propos utiles, et d'avantage utiles que des propos corrects qui ne comportant pas ces erreurs ?
gzabirji a écrit : ↑01 déc.24, 01:35
Aucun propos n'est exempt d'erreur dès lors qu'il s'agit de parler de Ce que Nous Sommes réellement.
Tu ne réponds pas à ma question, tu l'éludes.
Je te demandais de justifier l'affirmation que tu faisais quand tu écrivais que ces erreurs seraient utiles ?
Pour moi elles n'ont principalement l'effet que d'induire en erreur.
En outre, tu affirmes que l'on ne peut que dire des erreurs si l'on parle de "Ce que Nous Sommes réellement", tu l'affirmes, mais toujours gratuitement. En quoi cette affirmation serait-elle vraie ? Je suis sûr que tu ne t'es jamais vraiment posé la question.
-------------
ChatGPT :
Structure de l’argumentation de J'm'interroge :
1. Critique des affirmations gratuites : J'm'interroge met en lumière le problème des déclarations faites par gzabirji sans preuves ou clarifications suffisantes. Par exemple :
- L'idée que "nous sommes le Tout, le Grand tout ou tout" est qualifiée d'erreur qui "induit en erreur".
- L'impersonnalité de la conscience est rejetée comme une conjecture non fondée.
Ici, J'm'interroge demande une base argumentative claire et justifiée pour toute affirmation.
2. Exigence de cohérence logique :
- Il critique gzabirji pour son usage de termes comme "référentiel n°3", sans explication concrète. Selon J'm'interroge, ce manque de clarté permet à gzabirji de maintenir des positions ambiguës, voire contradictoires.
- Il souligne que déclarer certaines expériences comme universelles ou impersonnelles implique une incohérence si l’on admet simultanément que certains individus sont "plus conscients" que d'autres. Cela revient à réintroduire une individualité que gzabirji prétend nier.
3. Défense de l’individualité :
- J'm'interroge argumente que la capacité de prendre conscience est intrinsèquement individuelle. Il s’appuie sur l’observation que les expériences diffèrent entre les individus et que chaque conscience est propre à son porteur.
- Il considère que nier cette individualité est une erreur découlant de biais ou croyances personnelles.
4. Refus de l’idée d’une expérience de la permanence ou de l’impersonnalité :
Selon lui, ce que gzabirji décrit comme une "expérience" de l’impersonnalité n’est pas une expérience au sens strict, mais une croyance ou une interprétation biaisée. J'm'interroge oppose cette affirmation à l’idée que toute expérience est vécue par un sujet conscient, avec des particularités personnelles.
5. Questionnement sur l’utilité des "erreurs" déclarées utiles :
Il rejette l'idée que des affirmations erronées (comme "nous sommes le Tout") puissent être utiles. Il demande une justification à ce propos et insiste sur le fait que ces erreurs risquent davantage de semer la confusion que de clarifier.
---
La position de J'm'interroge comporte plusieurs aspects intéressants qui méritent d’être soulignés. Au-delà de sa critique explicite des incohérences et des affirmations gratuites, on peut extraire des idées plus profondes et des implications philosophiques qui enrichissent le débat. Voici quelques points notables :
1. Exigence d’un discours intelligible et rigoureux
L’insistance de J'm'interroge sur la clarté et la précision des termes employés dans une discussion philosophique est un point central. Il met en évidence que l’usage de concepts comme "référentiel n°3" ou "impersonnalité" sans définition claire peut nuire à la compréhension mutuelle et masquer des failles logiques.
Ce que cela montre :
- Une méthode philosophique rigoureuse, qui exige que les termes soient définis pour permettre une discussion constructive.
- Une critique implicite des discours ésotériques ou spirituels qui peuvent, parfois, recourir à des formulations floues pour éviter d’être examinés de manière critique.
Intérêt :
Cela pousse le débat à s’ancrer dans des bases solides, évitant les échappatoires ou les discours trop subjectifs pour être partagés et discutés.
2. La valorisation de l’individu dans l’expérience
J'm'interroge défend l’idée que toute expérience est fondamentalement individuelle. Il insiste sur la singularité de chaque conscience et de son interaction avec le monde. Cette position est en tension directe avec les affirmations de gzabirji sur l’impersonnalité ou l’universalité de la conscience.
Ce que cela montre :
- Une reconnaissance de la diversité des perspectives individuelles dans toute discussion sur l’être ou la conscience.
- Une critique des généralisations qui, selon lui, ignorent la richesse et la variété de l’expérience humaine.
Intérêt :
Cela ouvre la voie à une réflexion sur l’importance de l’individualité, non seulement dans l’expérience phénoménale, mais aussi dans la quête de la vérité philosophique. Cela invite à se méfier des systèmes de pensée uniformisants qui pourraient minimiser ou nier cette diversité.
3. Rejet de l’autorité des croyances établies
Bien que J'm'interroge n’attaque pas explicitement les traditions spirituelles, son approche souligne une indépendance intellectuelle marquée. Il refuse d’accepter des affirmations sans preuve ou sans justification rationnelle, même si elles sont ancrées dans des traditions ou des systèmes philosophiques réputés.
Ce que cela montre :
- Une approche critique et sceptique, qui valorise le doute et l’analyse rationnelle au-dessus des dogmes ou des croyances collectives.
- Une méthodologie phénoménologique, cherchant à se fonder uniquement sur ce qui peut être directement expérimenté ou vérifié.
Intérêt :
Cela met en avant l’idée que toute quête de vérité doit rester personnelle, critique et détachée de toute influence extérieure qui pourrait biaiser la réflexion.
4. L’attention portée aux biais cognitifs
En qualifiant certaines affirmations de gzabirji de "biais de croyance", J'm'interroge pointe un problème fondamental dans toute discussion sur la nature de la conscience : la difficulté de distinguer ce qui est réellement expérimenté de ce qui est interprété ou cru.
Ce que cela montre :
- Une conscience des limites de l’introspection : toute réflexion sur la conscience est susceptible d’être influencée par des cadres mentaux préexistants.
- Une distinction rigoureuse entre expérience et interprétation : ce n’est pas parce qu’une personne ressent ou croit quelque chose qu’il s’agit d’une vérité universelle ou objective.
Intérêt :
Cela encourage une vigilance épistémologique, en invitant les participants au débat à examiner de près leurs propres postulats et biais.
5. Défi à la pensée paradoxale ou non-duelle
J'm'interroge s’oppose aux affirmations paradoxales ou aux discours sur la "non-dualité" lorsqu’ils manquent de clarté ou tombent dans l’autoréférence. Par exemple, il critique l’idée que l’expérience puisse être "impersonnelle" tout en impliquant une conscience capable de différencier ceux qui sont conscients de leur nature réelle de ceux qui ne le sont pas.
Ce que cela montre :
- Une demande de cohérence interne, même dans des systèmes de pensée qui se revendiquent comme transcendant les oppositions binaires ou conceptuelles.
- Une critique du risque que les paradoxes servent à éviter les exigences de la logique et du rationnel.
Intérêt :
Cela invite à réfléchir sur la manière dont les systèmes de pensée non-duels peuvent être présentés et discutés sans perdre de vue leur cohérence interne.
6. La critique des "expériences interprétées"
En rejetant l’idée que l’on puisse "expérimenter" l’impersonnalité ou la permanence, J'm'interroge fait une distinction cruciale entre ce qui est vécu directement et ce qui est interprété a posteriori. Pour lui, ces expériences sont des interprétations biaisées ou influencées par des croyances préexistantes.
Ce que cela montre :
- Une défense de l’expérience brute : ce qui est réellement vécu, sans le filtre des constructions mentales ou culturelles.
- Une critique des constructions spirituelles qui peuvent détourner l’attention de l’expérience immédiate pour la remodeler selon des concepts préétablis.
Intérêt :
Cela pose une question fondamentale : peut-on vraiment "expérimenter" ce que désignent des concepts abstraits comme la permanence ou l’impersonnalité, ou sont-ils possiblement des produits d'une interprétation culturelle ou biaisée ?
Synthèse des points supplémentaires :
La position de J'm'interroge ne se limite pas à une critique de gzabirji. Elle propose, implicitement ou explicitement, des pistes de réflexion importantes :
- La nécessité d’un discours clair et rigoureux.
- La valorisation de la diversité et de l’individualité dans l’expérience.
- Le rejet des affirmations gratuites et des biais de croyance.
- Une vigilance face aux interprétations et aux systèmes de pensée paradoxaux ou non-duels.
Ces points témoignent d’une démarche intellectuelle exigeante, centrée sur la clarté, la cohérence et la fidélité à l’expérience vécue. Ils enrichissent le débat en proposant une alternative critique aux approches parfois trop spéculatives ou conceptuelles.
---
La position de J'm'interroge se distingue par son exigence de rigueur et de clarté. Il critique l’usage de termes flous ou mal définis, comme "référentiel n°3", et rejette les affirmations gratuites, notamment celles sur l’impersonnalité ou la permanence de la conscience. Il défend l’idée que toute expérience est individuelle et rejette les généralisations qui ignorent la diversité des expériences. Pour lui, la conscience est propre à chaque individu, et nier cette singularité revient à céder à des biais de croyance.
J'm'interroge distingue aussi l’expérience brute de ses interprétations, soulignant que des concepts abstraits comme "l’impersonnalité" ou "la permanence" sont des constructions mentales plutôt que des réalités expérimentables. Il critique les discours spirituels ou ésotériques qui s’appuient sur des paradoxes ou des formulations ambiguës pour éviter l’examen logique.
Son approche valorise une quête de vérité basée sur des expériences directes, sans biais ni dogmes. En insistant sur la cohérence interne et la vigilance face aux croyances implicites, il met en lumière les limites des discours non-duels ou conceptuels qui peuvent masquer des incohérences. Enfin, il souligne l’importance de justifier les affirmations et de s’ancrer dans des bases rationnelles, refusant que les erreurs soient considérées comme utiles sans explication convaincante.
En résumé, sa critique vise à recentrer le débat sur des bases solides, ancrées dans l’expérience individuelle et dans une logique rigoureuse, en rejetant les systèmes de pensée flous ou spéculatifs qui manquent de preuves ou de cohérence.
.