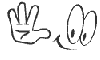marco ducercle a écrit :Il ne t'as pas échappé que Charles Martel n'est pas un prophète et qu'on ne se fait pas traité de christianophobe quand t'on le critique
Le triomphe de la barbarie sur la civilisation
Stoppée en Occident par la victoire de Charles Martel, bloquée devant Byzance par la résistance de Léon III et de Justinien II, l’expansion arabe avait atteint en 743, des limites qu’elle ne dépasserait plus. Grâce à la force des Francs et à la ténacité des Grecs, l’Europe devait rester en dehors de son emprise. Mais la domination musulmane ne s’en étendait pas moins de Narbonne à Kashgar ; et le Calife, « cette image de la divinité sur terre » se trouvait à la tête d’un empire plus vaste que ceux de Darius ou d’Alexandre le Grand.
Jamais entreprise aussi considérable n’avait été réalisée en un aussi petit laps de temps, et les chroniqueurs de l’époque n’eurent pas tort de la comparer à une tempête. Plus de douze mille kilomètres séparaient les positions extrêmes occupées par les Arabes en Orient et en Occident. Pourtant il ne s’était écoulé que cent vingt-deux ans depuis le serment d’Akaba, c’est-à-dire depuis le jour où, rassemblant autour de lui une quarantaine de guerriers, Mahomet avait constitué le noyau initial des armées islamiques.
![trophy [1]](./images/smilies/trophy.gif)
Dans une partie précédente, nous ramenions les témoignages de Gustave Le bon et d’Adolphe Hitler qui regrettaient presque qu’un certain Martel, Charles de son prénom, prennent le dessus sur les armées musulmanes porteuses des lumières de l’époque. On peut trouver ces témoignages douteux, mais que dire du Pr Claude Farrère de l’Académie française qui déplore cette triste réalité ? « L’an 732 de notre ère, une catastrophe, la plus néfaste peut-être de tout le Moyen-âge s’abattit sur l’humanité ; et le monde occidental en fut plongé, pour sept ou huit siècles, sinon davantage, au tréfonds d’une barbarie que la renaissance commença seulement de dissiper, et que la réforme faillit épaissir à nouveau. Cette catastrophe dont je veux détester jusqu’au souvenir, ce fut l’abominable victoire que remportèrent, non loin de Poitiers, les sauvages harkas des guerriers francs conduits par le carolingien Charles Martel, sur les escadrons arabes et berbères que le calife ‘Abd Ar-rahmane ne sut pas concentrer assez nombreux, et qui succombèrent devant les guerriers francs. En cette journée funeste, la civilisation recula de huit cents années. Il suffit, en effet, de s’être promené dans les jardins d’Andalousie ou parmi les ruines éblouissantes encore de ces capitales de magie et de rêve que furent Séville, Grenade, Cordoue, voire Tolède, pour entrevoir, dans un miraculeux vertige, ce qu’il serait advenu de notre France, arrachée par l’Islam industrieux, philosophe, pacifique et tolérant – car l’Islâm est tout cela – aux horreurs sans nom qui dévastèrent par la suite l’antique Gaulle.
Celle-ci fut asservie d’abord aux féroces bandits austrasiens, puis morcelée, déchirée, noyée de sang et de larmes, vidée d’hommes par les croisades, gonflée de cadavres par tant et tant de guerres étrangères et civiles, alors que, du Guadalquivir à l’Indus, le monde musulman s’épanouissait triomphalement dans la paix sous l’égide quatre fois heureuse des dynasties ommeyade, abbaside, seldjoukide, ottomane. A ces français, je demanderai ensuite ce qu’ils pensent de « notre » victoire de 732 sur les musulmans ? Et s’ils ne jugent pas avec moi que cette défaite d’un peuple civilisé par un peuple barbare fut, pour l’humanité entière « un grand malheur ? ».
Le savant espagnol Blanco Ibanez parait bien placé pour nous peindre cet insolite tableau andalous « Dans l’ombre de la Cathédrale » : « L’Espagne, esclave de rois théologiens et d’évêques belliqueux, recevait à bras ouverts ses envahisseurs. En deux années, les Arabes s’emparèrent de ce que l’on mit sept siècles à leur reprendre. Ce n’était pas une invasion qui s’imposait par les armes, c’était une société nouvelle qui poussait de tous côtés ses vigoureuses racines. Le principe de la liberté de conscience, pierre angulaire sur laquelle repose la vraie grandeur des nations leur était cher. Dans les villes où ils étaient les maîtres, ils acceptaient l’église du chrétien et la synagogue du juif. »[2]
« Saint Ferdinand, écrit de son côté Viardot, se rendit à la mosquée et ce magnifique ouvrage du premier ‘Abd Ar-rahmane fut consacré au culte chrétien… Mais les autres monuments que nul caractère sacré ne protège contre une avidité barbare, contre une haine fanatique, disparurent dans les pillages et les dévastations de la conquête. Il ne resta rien, ni des riches abords de la mosquée, ni du merveilleux palais d’Al-Zahra… Des colonnes solitaires sont là pour attester que des nations civilisées occupaient jadis le vide inculte du désert. »[3]
Pour sa part, un auteur contemporain écrit : « Les chrétiens qui n’avaient pas renié leur foi sont globalement appelés « Mozarabes » ; ils ne sont pas persécutés et vivent en bonne entente avec les Arabes et les chrétiens convertis à l’Islam (…) Les conquérants arabes n’ont mis aucune entrave à la religion chrétienne ; l’Espagne conquise a conservé les diocèses de l’Espagne chrétienne et il y a trois archevêques (Tolède, Lusitanie, Bétique). Les villes d’al-Andaloûs comptent de nombreuses communautés juives entièrement libres civilement et religieusement, comme les chrétiens, dont les quartiers sont appelés par les Arabes « la ville juive » (madinat al-yahoûd). Les juifs, banquiers, prêteurs, gabeleurs, ont joué un rôle important de financiers, mais aussi de conseillers et d’ambassadeurs, au service des musulmans ou des chrétiens. »[4]
« Quant aux non musulmans, écrit l’historien Sâmih ‘Atef Ezzayn, ils sont laissés à leurs convictions et adoration ; ils suivent dans leurs affaires de mariage et de divorce les lois de leur religion. L’État nomme un juge pour décider de leurs différends devant les tribunaux gouvernementaux. Quant aux nourritures et vêtements, ils sont laissés à leur propre convenance, conformément aux prescriptions de leur religion, mais tout en respectant l’ordre général. Les transactions et les sanctions s’appliquent sur le même pied d’égalité aux musulmans et non musulmans, sans nul égard à la religion, à la race ou au sexe. »[5]
« Le 3 janvier 1492, écrit un historien français, le dernier prince de la dynastie nasride, se rendra aux rois catholiques, et l’histoire de l’Espagne sera définitivement chrétienne. Il ne restera plus dans la péninsule, une fois ces innombrables guerres oubliées, que le souvenir éblouissant de la culture arabo-andalouse : la mosquée de Cordoue, l’Alhambra de Grenade, les œuvres des écrivains, des savants, des philosophes, des théologiens et des traducteurs andalous qui ont communiqué leur savoir aux francs barbares et ignorants que nous étions alors. »[6]
Un autre auteur ajoute dans cette optique : « L’influence qu’exerça l’Islâm dans l’édification de la culture occidentale du Moyen-âge fut donc décisive. Le monde chrétien, quant à lui, sut aborder des formes de vie intellectuelles et artistiques, très différentes des siennes, disposé parfois à dialoguer mais toujours à apprendre puisque cette communication du savoir se faisait dans une seule direction, de l’Orient vers l’Occident. Les deux mondes, ensuite, se renfermèrent sur eux-mêmes. L’Orient, après tant de splendeur, se cristallisa dans la contemplation de sa grandeur passée ; l’Europe fut prise par le mythe de l’adoration de l’homme et par l’exaltation d’elle-même comme gardienne de la civilisation et de la vérité. »[7]
« D’où provient cette force d’attraction qui pousse les Grecs, les Syriens, les Égyptiens, dépositaires à la fois des civilisations antiques et de la civilisation chrétienne, à se rapprocher aussi rapidement que possible de la civilisation musulmane ? se demande le Pr Haider Bammate.
« Il n’est qu’une réponse à cette question, écrit Henri Pirenne, et elle est d’ordre moral. Tandis que les Germains n’ont rien à opposer au Christianisme de l’empire, les Arabes sont exaltés par une foi nouvelle. C’est cela, et cela seul, qui les rend inassimilables. Car, pour le reste, ils n’ont pas plus de préventions que les Germains pour la civilisation de ceux qu’ils ont conquis. Au contraire, ils se l’assimilent avec une étonnante rapidité. En science, ils se mettent à l’école des Grecs, en art à celle des Perses… ils ne demandent pas mieux, après la conquête, que de prendre comme un butin la science et l’art des infidèles ; ils les cultiveront en l’honneur d’Allah. Ils leur prendront même leurs institutions dans la mesure où elles seront utiles. »[8]
Voir :
http://www.lelibrepenseur.org/lislam-et-loccident/
![trophy [1]](./images/smilies/trophy.gif)
Jacques Benoist-Méchin, Ibn Séoud ou la naissance d’un royaume.
![silver [2]](./images/smilies/silver.gif)
Cité par Roger Garaudy dans son livre « Promesses de l’Islâm », éditions Le Seuil, Paris 1981.
![bronze [3]](./images/smilies/bronze.gif)
Cité par Ahmed Rédha Bey dans son livre « La faillite morale de la politique occidentale en Orient », éditions Bouslama, Tunis 1997.
[4] Cf. « Le génie de l’Islamisme », par Roger Caratini, éditions Michel Lafon, Paris, 1992.
[5] In. Samih ‘Atef Al-Zayn “L’Islâm et l’idéologie de l’homme”, éditions Dâr Al-Kitâb Al-lubnâni, Beyrouth, Liban.
[6] In. « Le génie de l’islamisme », op cité.
[7] Cf. « L’Europe musulmane », par Gabrielle Crespi, éditions Zodiaque, Paris, 1979.
[8] Cf. Henri Pirenne “Mahomet et Charlemagne », Paris 1937, cité par Haïdar Bammate dans son livre « Visages de l’Islâm », éditions Enal, Alger, 1991.
(10). Cf. «Haïdat Bammate « Visages de l’Islâm », éditions Enal, Alger 1992.