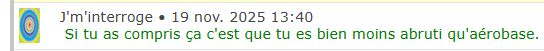J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
1. Tu crois encore que parler de structure = parler d’une chose.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Je ne le pense même pas... J'insiste sur le réel pour mieux fonder l'absolu...
Tu confirmes exactement ce que je décris.
Tu ne réponds pas à la distinction entre « structure » et « chose », selon ta conception absolutiste de ce que serait une chose : tu déplaces immédiatement le débat vers « fonder l’absolu ».
Donc tu réifies implicitement : dès qu’on ne parle plus de chose selon ta conception, tu ramènes sur le tapis ton idée de « fondement réel » qui doit se comporter comme une substance ou un substrat absolu.
Tu ne réfutes rien, tu illustres le mécanisme.
Tu insistes sur le réel pour tenter de fonder ton « absolu » en effet, mais tu ne l'établis pas.
Le réel n'a rien d'absolu et n'a pas besoin d'un absolu pour être fondé. Tout ce qui existe ne requiert qu'une chose : être possible, non d'être absolues, ni d'être portées par un absolu, ni d'être contenue en un absolu, lequel est un concept creux ne référant à strictement rien de réel.
Visiblement, tu ne parviens pas à intégrer.
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
Autrement dit : si ce n’est pas un objet ou quelque contenant ou support support absolus, ce n’est pas réel.
C’est exactement ce que je décris : tu refuses qu’une structure d'interdépendances soit réelle autrement qu’en la réifiant. Il te faut la peupler d'objets absolus ou lui donner une substance absolue pour la considérer comme réelle.
Mais cette trame des possibles évoquée n'est en rien abstraire. Tu confonds structure et abstraction.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Votre
structure n'est pas réelle, puisque lui échappe son caractère dynamique... Le mot même est réifiant. Le mot
interdépendances sauve un peu la face, mais pas totalement... Un autre terme, mieux choisi, clarifierait le concept, lui donnerait vie...
Vous ne construisez pas le réel, vous l'imaginez...
C’est une inversion accusatoire typique : tu reproches au terme « structure » d’être réifiant, alors que ton propre discours exige un substrat ou une substance absolue pour accorder qu'une réalité structurelle le soit.
Tu réclames d’abord un substrat absolu, puis tu accuses la structure dont je parle d’être « abstraite » si elle n'est pas absolue ou n'a pas de fond ou de contenant absolu.
Tu confonds « non-substantiel » avec « irréel ».
Et tu n’expliques pas pourquoi une structure dynamique relationnelle ne serait pas réelle autrement qu’en lui conférent une nature, un support ou un contenant absolu.
Cela confirme le point : pour toi, la réalité doit être un « un quelque chose », quelque chose qui soit substantiel selon ta notion. Sinon, tu la déclares imaginaire. Mais ta notion ou ton concept de la « chose » ne sont pas moins imaginaires ou abstraits en plus d'être complètement injustifiés.
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
2. Tu reproches au Champ des possibles d’être
« spatialisant ».
C’est précisément le problème : je n’en fais jamais un espace, et toi tu en poursuis la spatialisation presque par réflexe.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Je ne reproche pas au Champ d'être spatialisant, je dis qu'il l'est....
Ce n'est pas un réflexe, mais bel et bien une évidence vu le terme même. On imagine mal un champ quelque abstrait qu'il soit non spatialisant...
C’est exactement ce que je pointe :
Tu projettes spontanément une spatialité là où elle n’existe pas.
Je définis un champ structurel en précisant que ce qui est de nature spatiale est fondamentalement structurel, non comme étant spatial en ton sens.
Tu dis : « on imagine mal ».
Ce n’est pas un argument, c’est ton inertie conceptuelle.
Et tu contredis ta phrase précédente où tu disais que tu ne faisais « rien de tel ».
Pour rappel, c'est bien toi qui écrivais ceci et non moi :
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 09:19
Je n'ai pas encore parlé de spatial, même s'il peut être considéré comme tout aussi nécessaire pour quelque apparition...
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 09:19
Tout comme votre champ des possibles est spatialisant dans son essence même, autant qu'il l'est par ce qui le constitue en tant que champ...
N'est-ce pas ?
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
Tu traduis « trame relationnelle » en
« champ spatial ».
C’est l’erreur que je désigne : tu spatialises ce qui n’est pas spatial.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Je ne traduis rien du tout puisque je n'en parle même pas, ni ne l'ai même considéré...
Je ne fais que remettre dans une perspective qui tient compte du réel...
C’est incohérent : tu dis ne pas « traduire », mais tu déclares un peu plus haut que le champ est nécessairement spatial.
Donc tu traduis bel et bien, mais tu refuses de reconnaître que tu le fais.
Et tu traduis mal. Tu interprètes selon ton idée.
Encore une illustration parfaite de ce que je pointais : tu confères une spatialité à un concept non spatial d'une réalité qui ne l'est pas plus, puis tu nies l’opération.
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
3. Tu réintroduis la totalité sous un autre mot.
Tu refuses « Tout absolu », alors tu inventes
« absolu globalisant », mais c’est la même chose :
une totalité qui embrasse tout sans rien laisser hors d’elle.
Tu ne démontres rien, tu réintroduis constamment tes postulats, tout en niant que tu le fais.
C’est exactement ce que je désignais quand je parlais d'une totalisation automatique.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Je ne refuse pas en soi l'expression 'Tout absolu'... C'est le paradoxe absurde qui m'empêche de l'utiliser au nom du langage formel. En logique informelle, l'expression ne cause aucun problème... Vous inventez un problème dont vous faites une patate chaude...
Le réel est le champ des possibles...
Tu fais exactement ce que je décrivais :
Tu changes les mots pour contourner la contradiction, mais tu réintroduis la même architecture formelle totalisante :
un principe englobant, clos, fondement nécessaire et omniprésent.
Tu dis que « l’expression pose problème », mais pas le concept.
Autrement dit : tu refuses le mot, mais tu gardes la chose.
C’est précisément la totalisation automatique que je décris.
Et ta dernière phrase — « Le réel est le champ des possibles » — réintroduit une identité totale (le réel = tout ce qui peut être), identité qui contredit ton refus nominal du « Tout absolu ».
Tu confirmes donc, encore une fois, ce que tu prétends réfuter, tout en présentant l'incohérence de ce que tu énonces comme un faux problème logique, parce que selon
ta "logique informelle", ce ne serait pas incohérent.
Ceci d'un ridicule au plus haut point.
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
4. Tu continues de faire du Champ des possibles un absolu, malgré mes explications.
Tu écris :
« Votre champ des possibles est spatialisant dans son essence même »
— mais c’est faux, et je l’ai répété dix fois.
Tu me prêtes ta propre projection, sans tenir compte des implications logiques de ma définition.
Autrement dit : tu absolutises ce qui n’a rien d'absolu et n'en requiert aucun, et tu m’attribues ta projection.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
J'ai mené le Champ des possibles à sa pleine expression, tout comme je l'ai fait pour l'absolu... Dans les deux conceptions, vous trouverez ''ce qui est''...
Tu absolutises le Champ… puis tu dis que tu ne le fais pas :
Tu dis « mener à sa pleine expression », mais cela signifie :
le transformer en principe ultime, englobant, nécessaire — c’est-à-dire un absolu.
Tu ne réfutes donc pas l’objection : tu l’admets, mais en niant que ce soit problématique.
Ensuite, tu imposes l’absolu comme condition du réel malgré la définition que je propose qui ne l'implique en rien, sans discuter ses implications et ce qu'elle n'implique en rien nécessairement.
Tu substitues ta métaphysique à l’analyse de structure, puis tu déclares que cela invalide l’analyse.
C’est circulaire.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Vos explications ne changent rien à ma considération de l'absolu qui a l'avantage de fonder la réalité, toute réalité...
Tu reconnais ici que ton absolu n’est pas une conclusion, mais un présupposé.
Tu ne montres pas que l’absolu est nécessaire : tu déclares qu’il l’est, puis tu refuses toute possibilité conceptuelle qui ne l’inclut pas.
C’est exactement le mécanisme que je décrivais :
dès qu’un concept n’est pas « fondé » par un absolu, tu le déclares incomplet, insuffisant, « pure abstraction », etc.
Tu ne réfutes pas la structure relationnelle : tu imposes simplement ton ontologie comme condition préalable.
Et l’argument « l’absolu fonde toute réalité » est pure pétition de principe.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Et dire que nous n'avons même pas encore statuer sur la matière...
Dévier vers la matière pour éviter la contradiction.
C’est une digression qui sert uniquement à déplacer la discussion.
Tu passes à un autre sujet au moment précis où la contradiction logique de ton absolu apparaît.
Ce n’est pas une ouverture à un développement : c’est une esquive.
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
Tu confonds abstraction et structure. Les choses ne disparaissent pas parce que la structure n’est pas un objet : exiger que la structure soit une chose absolue ou que son existence soit absolue pour être réelle, c’est simplement refuser qu’une réalité puisse être relationnelle et donc sans existence intrinsèque autonome, plutôt que substantielle. C'est de cela qu'il est question quand je dis que tu ne peux pas t'empêcher de réifier, et que tu ne l'intègres pas.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Je ne réifie pas l'absolu, je lui reconnais sa dimension en tant que fondement du réel. Sans l'absolu, pas de réalité... Le mot sonnant un peu 'fermé' je l'ouvre pour qu'il recouve 'ce qui est'...
Tu confonds encore structure et substance, nature, substrat ou contenant absolus.
Tu réifies explicitement ici :
– tu attribues à l’absolu une fonction,
– un statut ontologique,
– une présence,
– un rôle causal.
Dire « fondement du réel » est déjà une réification.
Dire « recouvre ce qui est » en est une seconde.
Dire « nécessaire pour qu’il y ait réalité » en est une troisième.
Et l’argument « je l’ouvre pour qu’il recouvre ce qui est » est une modification rhétorique du mot, pas une argumentation.
Tu changes la définition pour éviter les contradictions, tout en conservant un absolu substantiel.
D’où la remarque initiale : tu réifies ce qui n’a pas besoin de l’être.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Collez-lui le mot dieu, si ça vous chante, mais au moins retenez que ce n'est pas celui de la Bible...
Tu confirmes implicitement ce que je disais :
tu construis une figure fonctionnellement identique à un principe divin — totalité, fondement, nécessité, omnienveloppement — mais tu changes l’étiquette pour ne pas l’assumer comme tel.
Ce n’est pas moi qui « colle » le terme, c’est toi qui en reprends tous les attributs conceptuels.
Changer le nom ne change pas la nature du concept.
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
Comment ce qui est censé n'être relatif à rien, pourrait-il être en rapport avec ce qui est par nature relatif ?
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Le relatif est nécessaire comme illusion... Mais on peut aussi le considérer comme absolu...
Contradiction sur le rapport relatif/absolu :
Tu affirmes deux propositions incompatibles :
- 1. le relatif est une illusion ;
- 2. le relatif peut être considéré comme absolu.
Si le relatif est absolu, il n’est pas relatif.
Si le relatif est illusoire, il ne peut pas être absolu.
Aucune des deux phrases n’explique la relation entre les deux niveaux.
Tu les tiens ensemble sans médiation logique, simplement parce qu’elles te permettent de préserver ton concept d’absolu à tout prix.
Tu réponds à une contradiction en en produisant une plus grande.
J'm'interroge a écrit : 18 nov.25, 13:21
Tu prétends ne pas être dans un discours théologique.
Mais tu parles d’un
« absolu fondement de tout »,
« nécessaire »,
« de part en part dans le réel »,
« globalisant »,
« auquel rien n’échappe ».
C’est exactement la logique théologique (au sens conceptuel, pas religieux) : un principe ultime, totalisant, servant de garant à tout le reste.
Tu peux appeler ça
« ontologique » ou
« spinozien », mais c’est le même schéma : un Absolu-fondement.
Donc oui : tu reformules des postulats de la théologie classique avec d’autres mots.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
- Oui, nécessaire, et absolument...
- Mais non seulement de part en part dans le réel, mais le réel lui-même...
- Globalisant, auquel rien n’échappe, oui et encore oui, puisqu'il n'y a rien au-delà, pas d'au-delà...
Tu confirmes textuellement la structure théologique de ton discours
Tu confirmes point par point :
– nécessité,
– totalité,
– rôle de fondement,
– omniprésence,
– absence d’extérieur possible.
C’est la définition stricte d’un absolu-théologique (au sens conceptuel, non religieux).
Puis tu ajoutes :
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Si le champ des possibles est pour vous la réalité, eh bien, il pointe l'absolu que je révèle...
C’est exactement la projection que je pointais :
tu prends un concept neutre, n'impliquant aucune substantialité, et tu l’interprètes comme une ébauche de ton absolu.
Tu traduis chaque terme dans ton cadre — puis tu déclares que le terme pointe nécessairement vers l’absolu.
C’est circulaire et autorefermé.
Conclusion synthétique
– Tu absolutises ce qui n’est pas absolu.
– Tu spatialisises ce qui n’est pas spatial.
– Tu réifies ce qui n’est pas substantiel.
– Tu totalises ce qui n’est pas un Tout.
– Tu attribues ensuite ces projections à l’autre.
Et tu confirmes toutes ces opérations dans tes réponses, tout en affirmant faire « l’inverse ».
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Que voulez-vous, puisque ''ce qui est'' est...
« Ce qui est est », ou le faux refuge tautologique :
C’est une tautologie vide que tu utilises comme justification.
Elle ne démontre rien, elle ne clarifie rien.
Elle sert seulement à rendre à tes yeux ton absolu inattaquable en le repliant sur l’évidence brute :
on ne peut pas réfuter une tautologie, mais on ne peut pas en tirer un absolu non plus.
Tu ériges un principe métaphysique à partir d’une évidence grammaticale.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
C'est vous qui projetez un problème sur un mot...
Non : le problème vient du fait que tu changes la définition du mot “absolu” à chaque fois qu’une contradiction logique surgit.
Quand l’absolu doit être non-relatif, tu l’affirmes.
Quand il doit entrer en rapport avec le relatif, tu le rends « ouvert ».
Quand il doit envelopper tout, tu dis qu’il est « globalisant ».
Quand cela devient contradictoire, tu dis que ce n’est « qu’un mot ».
C’est précisément cette fluctuation conceptuelle à géométrie variable qui est pointée.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Même votre Champ des possibles, les structues, etc. si tout cela existe, c'est grâce à la réalité de l'absolu, seul à même de rendre compte de l'actualisation de l'improbable...
C’est l’illustration parfaite du mécanisme que je décrivais :
tu prends un concept qui n’a pas besoin d’un absolu, puis tu déclares qu’il en dépend nécessairement, parce que ton système de croyances ne fonctionne qu’avec un fondement ultime.
Tu réintroduis l’absolu comme clé universelle, puis tu affirmes que tout concept valide doit « pointer vers lui ».
C’est exactement le noyau théologique du discours.
C'est circulaire.
ronronladouceur a écrit : 18 nov.25, 15:31
Si le champ des possibles est pour vous la réalité, eh bien, il pointe l'absolu que je révèle...
J'ai déjà répondu plus haut à cette remarque.
Conclusion :
– ton « absolu » est un postulat non démontré ;
– tu ne lis jamais un concept indépendamment de ton cadre ;
– tu réinterprètes tout comme dépendant d’un fondement ultime ;
– et tu changes la définition du mot « absolu » selon les besoins du moment.
Ce n’est pas une réponse à mes objections : c’en est l’illustration.
Récapitulatif :
1. Le malentendu central : tout est immédiatement réinterprété comme « chose » ou « fondement » substantiels.
Chaque fois que je parle de structure, de relations, de compatibilité, tu traduis cela en termes de substance, de support, de contenant total ou d’objet réel selon ton idée. Pour toi, une structure n’est réelle qu’à condition d’être fondée sur quelque chose d’absolu, d'être absolue ou d'avoir son existence dans un cadre absolu. Tu refuses donc l’idée d’un réel relationnel sans substrat ultime et insubstantiel : tu réifies automatiquement ce qui, par définition, n’est pas abordée comme une chose selon ton idée. C’est pourquoi tu trouves la structure telle que je l'aborde « abstraite » : tu la lis à travers un cadre substantiel qui la rend nécessairement incomplète à tes yeux.
2. Les projections constantes : spatialisation, totalisation, absolutisation.
Tu transformes la trame relationnelle en espace (« un champ spatial »), la compatibilité en totalité (« globalisant, rien n’y échappe »), et la non-clôture en absolu (« fondement de tout »). Ces glissements ne viennent pas de mes concepts, mais de ton propre cadre : tu projettes spontanément tes catégories de spatialité, de totalité et d’absolu sur tout ce qui prétend avoir une portée générale. Ta réponse ne discute pas mes thèses : elle reformule mes termes dans ta grammaire métaphysique.
3. L’absolu comme postulat non démontré et comme clé universelle.
Tu ne démontres jamais la nécessité de l’absolu : tu l’installes comme condition préalable de tout discours sur le réel. Dès qu’une notion est évoquée — structure, potentiel, réalité — tu affirmes qu’elle dépend de l’absolu pour « être réelle ». Or cette dépendance n’est ni argumentée ni justifiée : elle est simplement affirmée. Tu changes même la définition du mot « absolu » selon les contraintes logiques du moment, en le rendant tantôt non-relatif, tantôt ouvert, tantôt identique au réel. Ce n’est pas une précision : c’est une stratégie pour maintenir le postulat coûte que coûte.
4. Une théologie conceptuelle non assumée.
Tu nies toute dimension théologique, mais tu en reproduis exactement la structure : un principe ultime, nécessaire, global, omnienveloppant, garant de tout ce qui existe. Ce n’est pas religieux, mais c’est théologique au sens conceptuel : la recherche d’un fondement absolu, premier, indispensable. Et tu recodes toutes mes notions — structure, compatibilité, possible — en direction de ce pseudo fondement. Ainsi, loin de réfuter mes critiques, ta manière de répondre les confirme : tu ramènes systématiquement chaque concept à ton « Absolu », sans jamais voir que ce geste est précisément ce qui est critiqué ici.
.- La réalité est toujours beaucoup plus riche et complexe que ce que l'on peut percevoir, se représenter, concevoir, croire ou comprendre.
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !