La théorie de l'évolution
- ultrafiltre2
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 3329
- Enregistré le : 09 mai15, 02:44
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 05 déc.16, 00:28merci Tiel pour ta discrétion et ton humilité
Je sais que tu connais ton bien ton sujet
JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie
par contre (certes) rien n'interdit à quelqu'un qui connait bien la biologie de faire le choix lui même des objets mathématiques qui lui servent
bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (désolé pour ma franchise)
Je sais que tu connais ton bien ton sujet
JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie
par contre (certes) rien n'interdit à quelqu'un qui connait bien la biologie de faire le choix lui même des objets mathématiques qui lui servent
bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (désolé pour ma franchise)
the sound - contact the fact l’hyper monde est un infty-simplexe triangulairement scalairisé
...ccnc ...et la lumière fut
...ccnc ...et la lumière fut
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 05 déc.16, 03:08Oui les mathématiques et la la biologie sont deux choses différentes. Entre autre, Darwin n'est pas un mathématicien mais un naturaliste (c'est dans le domaine des sciences naturelles, qu'il a surtout brillé). La théorie de l'évolution n'est pas un théorème de mathématique.ultrafiltre2 a écrit :JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie
Quand on parle de races en science naturelle, c'est selon un sens biologique (pas selon un sens racialiste colonialiste, nazi, ou autre). Ensuite si on veut croire personnellement en des théories racialistes "c'est pas un problème". Mais en science naturelle, c'est un problème d'utiliser le mot race à la place d'ethnie, de types humains ect. Car il a un sens bien réel, qui n'est pas du tout celui des racialistes. La nature (d'elle même) ne crée pas des races dans des espèces. Ce sont des humains qui créent des races dans des espèces. Exemple: le chien.
Tant mieux, mais je rappelle que la science (et la théorie de l'évolution, c'est de la science) ce n'est pas une croyance ni une idéologie. Donc les choses se vérifient et il est plus sage parallèlement de faire soi-même ses propres recherchent. D'une part, car un individu peut toujours faire des erreurs ou se tromper. Mais aussi parce que la théorie de l'évolution réfute scientifiquement notamment bon nombre de doctrines religieuses ou sectaires. Donc il y a notamment des compagnies créationnistes qui cherchent à la démolir, à la discréditer ect. afin de mieux servir leur paroisse idéologique (pour ne pas dire leur folie)ultrafiltre2 a écrit :bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (JMI) (désolé pour ma franchise)
Modifié en dernier par Erdnaxel le 05 déc.16, 16:40, modifié 1 fois.
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 05 déc.16, 05:59Et c'est là que tu te plantes, déjà bonne chance pour déterminer quelle variation génétique a une cause culturelle, on ne parvient souvent même pas à affirmer si telle ou telle variation génétique a une origine sélective ou pourquoi elle a été sélectionné, et pour cause très souvent on ne peut pas. L'autre point est que vouloir définir des races qu'en prenant en compte les isolements et variations génétiques, causé par un élément culturel, revient à assoir son postérieur sur l'essentiel de la variabilité génétique différenciant différentes populations, d'origine purement aléatoire et sur laquelle la dérive génétique joue un rôle prépondérant.J'm'interroge a écrit :(1) Je te détrompe, j'envisage bien la dérive génétique comme ce qui entraîne le résultat identifiable en termes comparatifs dont je parlais, sauf que pour distinguer les races, je ne considère que l'isolement génétique l'amenant qui est causé par un élément de culture.
Sauf que le concept de sous-espèce est lui-même très imparfait, et certaines classifications en sous-espèces date et sont plus poursuivit par tradition que par réelle rigueur scientifique. Chez certaines espèces cette subdivision marche bien, chez d'autres c'est un bordel sans nom. Mais surtout si on pratique une subdivision en sous-espèces chez les animaux avec des critères scientifiques prenant en compte bien évidemment l'ensemble de la diversité génétique et phénotypique, alors les mêmes critères s'appliquent à l'homme, ce qui implique de prendre l'ensemble des variations génétiques et phénotypiques au sein de l'espèce humaine et non pas celles qui auraient été causer ou déterminer par de seuls raisons culturelles. Mais d'ailleurs combien de races humaines définis-tu? Ce serait bien que tu sois un minimum concret.J'm'interroge a écrit :Comme je l'ai dit plus haut : pour ce qui est des facteurs naturels amenant à une dérive génétique et ou à une sélection naturelle, l'on possède déjà pour toute espèce [ y compris donc pour l'immense majorité de celles où la mémétique (l'équivalant chez les autres animaux de ce que l'on appelle "culture" chez l'Homme) ne joue pas, ou en tout cas pas de manière significative, ] un autre concept : celui de sous-espèces.
Premièrement distinguer de manière aussi dichotomique culture et nature, ne tient pas, surtout si tu t'aventures dans le domaine de l'anthropologie. Deuxièmement tu ne peux pas séparer ainsi ces deux concepts, surtout pas chez l'homme où facteurs naturels et culturels se côtoient et parfois combinent et parfois même se confondent.J'm'interroge a écrit :Je distingue donc le concept de "race" de celui de "sous-espèces". Parce pour ce qui est des "races" (si elles existent bien) et des "sous-espèces" la cause n'est pas la même. Elle est culturelle ou mémétique pour les races (si elles existent bien) et simplement naturelle pour les sous-espèces.
Mais les critères de différenciations génétiques pour différencier telle ou telle populations reposent sur des éléments strictement biologiques. On ne sépare pas la variations génétiques qui aurait été sélectionné en raison de facteurs culturels du reste de la variation génétique.J'm'interroge a écrit :J'ignore pourquoi tes définitions ne prennent pas en compte la simple dérive génétique (1). Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique.
Non car tu prends une définition du mot «race» qui ne prendrait en compte que les différenciations génétiques d'origine culturelle.J'm'interroge a écrit :Je partage cet avis. Mais je l'ai déjà dit plus haut dans un autre post.
Oui des exemples qui montrent que la résultant en terme de diversité génétique chez les hommes est comparable à ce qu'on observe chez des animaux d'élevage comme les chiens. Et j'ai déjà la réponse, la réponse est non.J'm'interroge a écrit :Je pense t'avoir répondu, mes définitions l'impliquent bien évidemment. As-tu une précision complémentaire à me demander à ce sujet ?
«Pour la diversité [celle des chiens], les résultats obtenus sont pratiquement à l'opposé de ceux qui se rapportent à l'espèce humaine. Bien que le nombre global de différences à l'intérieur de l'espèce, un peu moins d'une pour 1000 bases, soit comparable au cas humain, celles-ci apparaissent cette fois essentiellement entre les races. Chacune de ces dernières est en revanche extrêmement homogène.» Bertrand Jordan, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, Éditions du Seuil 2008
Bref cela confirme que la comparaison des populations humaines avec les races animales issues de l'élevage ne tient pas.
Non car les généticiens concrètement ont souvent déjà bien du mal à déterminer si telle ou telle variation génétique s'est répandue par sélection, et même si l'hypothèse sélective pour telle ou telle allèle est démontré souvent les raisons de cette sélection demeure inconnues. Le jour où tu aura un modèle mathématique qui permettra de distinguer tout cela tu auras peut-être un Prix Nobel et génétique, mais même dans cette hypothèse il n'y aurait aucune raison de faire des classifications raciales à partir des seuls variations génétiques qui ont été positivement sélectionner en raison de facteurs culturels et pas du reste de la variabilité génétique.J'm'interroge a écrit :En effet, d'où l'intérêt principal de la catégorie "race" car elle met en lien ce que j'appelle des éléments informationnels (monde II) et des processus naturels (monde I), comme la dérive génétique entre autre, mesurables et dont les résultats seraient facilement discernables in fine en termes de comparaisons de complexité de Kolmogorov (par exemple).
L'exemple des chiens montre que cette analogie ne fonctionne pas. Et cela surtout que les humains n'opèrent pas des choix de manière systématiques à l'échelle du temps, les cultures changes, les flux de gènes puissant, et les facteurs naturelles épidémie et dérive génétiques, redistribuant les cartes avec une grosse part de la variabilité génétique qui ne se laissera jamais capturé par le modèle hypothétique que tu proposes.J'm'interroge a écrit :La sélection humaine des reproducteurs dans les élevages d'animaux conduit à identifier ce que l'on appelle traditionnellement "races". La sélection s'opérant selon des choix humains (culturels), entre bien dans ma définition mais ne relèverait plus que du cas particulier.
Les généticiens actuels utilisent déjà des ordinateurs, y compris pour l'indice Fst, et ils sont au courant de la complexité du génome et de distribution de la variabilité génétique, mais justement ils tiennent compte de l'ensemble de la variabilité génétique.J'm'interroge a écrit :Oui c'est un indice intéressant mais avec l'outil que je propose, l'on ne se base plus sur un seul type d'indice, l'on compare par exemple un nombre au choix d'allèles ou de caractéristiques phénotypiques. C'est l’algorithme et la puissance de calcul de l'ordinateur qui font le reste.
Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.J'm'interroge a écrit :L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).
C'est pourtant bien ce que tu semble faire, et j'attends que tu sois plus précis et plus concret pour enfin déterminer où tu veux en venir.J'm'interroge a écrit :Ah non il n'est pas question de combiner de l'objectif et de l'informationnel ! D'ailleurs je ne vois pas comment l'on pourrait faire.
Ta présente comparaison ne clarifies absolument pas le modèle hypothétique que tu proposes.J'm'interroge a écrit :Par contre l'on peut très bien relier de l'objectif et de l'informationnel par des liens de nature mathématique. Comme l'a par exemple fait Shannon en liant mathématiquement son concept d'entropie, il ne l'a pas appelé ainsi pour rien, et celui d'information. En effet l'entropie de Shannon permet de donner un sens OBJECTIF en terme d'information à une valeur physique et inversement.
Les liens sont déjà fait depuis longtemps. Mais ça ne valide en rien ton hypothétique modèle.J'm'interroge a écrit :Dans mon cas il s'agit de faire un lien entre systèmes culturels et homogénies, entre arbres des filiations ou apparentements génétiques au sein de l'espèce humaine (biologie = base objective forte) et l'Histoire des peuples (éthnies) se fondant jusque là sur la recherche historique et l'archéologie (sciences humaines = base objective faible).
Encore une fois cela fait un moment que la génétique est venu aider les sciences humaines et historiques pour confirmer, infirmer, ou mettre à l'épreuve diverses hypothèses. J'ai l'impression que tu as un sacré retard en la matière, problème cela ne valide en rien tout ce que tu avais dit plus haut et cela ne valide non-plus en rien une notion de race appliqué à l'espèce humaine.J'm'interroge a écrit :C'est ce que permettrait mon approche en fournissant à ces sciences humaines une base objective (biologique) solide susceptible de trancher entre certaines hypothèses formulées, de révéler la fausseté de certains de leurs modèles et de fournir de nombreuses pistes inédites.
Déjà là tu te plantes un groupe ethnique et un groupe raciaux n'ont pas forcément à coïncider. Peut-importe qu'un descendant d'Africains de l'Est dont les parents ont émigré aux États-Unis il y a trente ans, se revendique comme Afro-Américain et que le regroupement Afro-Américain, compte des gens très éparses génétiquement, et ne forment pas un groupe génétiquement très cohérent, on peut défendre une ethnicité Afro-Américaine, sur des attribues purement culturels et identitaires. L'idée de filiation commune n'a même pas à être parfaitement avéré, à partir du moment qu'un ensemble d'individus cultive une culture, un sentiment fort d'appartenance à une identité culturelle commune, alors on peut parler d'ethnie, indépendamment de toute considération biologique. La génétique peut certes éclairer sur l'origine historique d'une ethnie, et sur sa filiation, mais elle ne définie pas en elle-même la réalité d'une ethnie au sens culturel et social du terme.J'm'interroge a écrit :En effet, je prévois d'ailleurs que certains groupes dit ethniques revendiqués tels, n'en serait pas en vrai, si groupes ethniques et groupes raciaux doivent coïncider, ce que nous dira la recherche.
Ben non, car ce que tu proposes ne tiendra pas et part sur plusieurs présupposés erronées. Il serait bien que tu tentes d'être davantage concret pour te rendre compte des failles évidentes de ton hypothèse.J'm'interroge a écrit :Non je t'assure. Tout dépend de ce qui ressortira de la recherche que je propose en comparaison avec les données des sciences humaines sur les liens d'apparentement entre ethnies.
Va falloir vraiment que tu sois plus concret pour donner un tant soit peu de crédibilité à ton hypothèse.J'm'interroge a écrit :S'il y aura manifestement bien des zones de coïncidences dans une proportion qui s'écartent de ce que prévoit le hasard, c'est que j'aurais tout bon.
Vraiment soit plus concret.J'm'interroge a écrit :Il y aura à peu près * autant de races que de points de congruence.
Non tu privilégie les facteurs culturels d'ailleurs valider biologiquement parlant, la méthodologie que tu proposes.J'm'interroge a écrit :Non non, j'incluais tous les facteurs possibles qui entreraient en jeu suite à un isolement de nature culturelle quel qu'il soit.
La dérive génétique est permanente et l'endogamie culturellement favorisée n'est pas le seul facteur, la simple isolation géographique d'un nombre limité d'individus peut faire l'affaire.J'm'interroge a écrit :Que pourraient donc faire suite à des habitudes ou préférences alimentaires due à des interdictions ou prescription religieuses, une mise à l'écart d'individus pour x raisons dont religieuses, ........ , l'endogamie, la haine d'un autre peuples, que sais-je encore... ou une combinaison de tous ces facteurs possibles tous ce ramenant quand même principalement à de l'endogamie, ce qui favorise effectivement, évidemment, la dérive génétique.
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 06 déc.16, 01:26Génétique (partie 1) encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/div ... ique/54999
"Partie de la biologie qui étudie les lois de l'hérédité.
Historique
Les Grecs, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avaient imaginé que certaines caractéristiques physiques des individus, appelées aujourd'hui caractères, se transmettaient des parents aux enfants. Mais il fallut attendre le milieu du 19ème siècle , avec les travaux du moine autrichien Johann Mendel, pour que les premières lois qui régissent la transmission héréditaire des caractères soient établies, en 1865.
Les découvertes de Mendel
Ces travaux consistaient à croiser des pois de couleurs et de formes différentes et à observer les caractéristiques des pois obtenus d'une génération à l'autre. Des observations de Mendel découlent deux des notions fondamentales de la génétique : d'une part, celle de phénotype (ensemble des caractères physiques et biologiques d'un individu) et de génotype (ensemble des caractères inscrits dans le patrimoine génétique d'un individu, qu'ils se traduisent ou non dans son phénotype) ; d'autre part, celle de caractère dominant (n'ayant besoin, pour se manifester chez un enfant, que d'être transmis par un seul des parents) et de caractère récessif (qui doit être transmis par le père et la mère pour se manifester chez l'enfant). Cependant, les lois de l'hérédité définies par Mendel tombèrent dans l'oubli et ne furent redécouvertes qu'au début du 20ème siècle.
L'avènement de la biologie moléculaire
Dans les années 1900 William Bateson, Carl Correns, Erich von Tschermak et Hugo de Vries redécouvrent les lois de l'hérédité de Mendel et contribuent à leur diffusion. Puis ce fut la découverte des gènes, de leur localisation sur les chromosomes, notamment grâce aux travaux de Thomas Morgan sur la drosophile (1915), des mutations génétiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty (1944) furent à l'origine de la génétique moléculaire en découvrant le rôle de l'ADN, dont la structure est établie aux débuts des années 1950 par les travaux de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, James Watson et Francis Crick ; la publication de Watson et Crick sur la structure en double hélice de l’ADN, qui marque la naissance de la génétique moléculaire, date de 1953.
Quelques années plus tard, François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff montrent l'existence de mécanismes régulateurs génétiques. Les années suivantes voient l'accès direct au gène que l'on peut désormais extraire et manipuler.
Les techniques apparues dans les années 1980 (notamment la PCR, → amplification génique) ont permis des progrès considérables. Le premier séquençage complet du génome d'un être vivant (une bactérie) a été réalisé en 1995, suivi l'année suivante par celui de la levure, premier eucaryote dont on ait décrypté la totalité des 6 100 gènes. Le projet Génome humain, initié en 1990, s’est terminé en 2003 : les trois milliards de bases (qui forment quelque 30 000 gènes) qui constituent le génome de l’espèce humaine ont été séquencées.
Le premier résultat important de la génétique des populations a été, en 1908, la découverte par un mathématicien britannique, Godfrey Hardy, et un biologiste allemand, Wilhelm Weinberg, de la loi (loi de Hardy-Weinberg) selon laquelle les fréquences des divers génotypes sont liées à celles des gènes et qui expose que, d'une génération à la suivante, l'équilibre se maintient.
Le trait le plus marquant de la génétique des populations depuis un quart de siècle est sans doute sa mathématisation croissante. Les recherches ont montré l'extrême polymorphisme des populations pour presque tous les caractères et que l'homogénéité des structures génétiques à laquelle on devrait théoriquement aboutir n'est pas atteinte. Le problème central de la génétique des populations reste celui de l'évolution du monde vivant.
Le support de l’information génétique
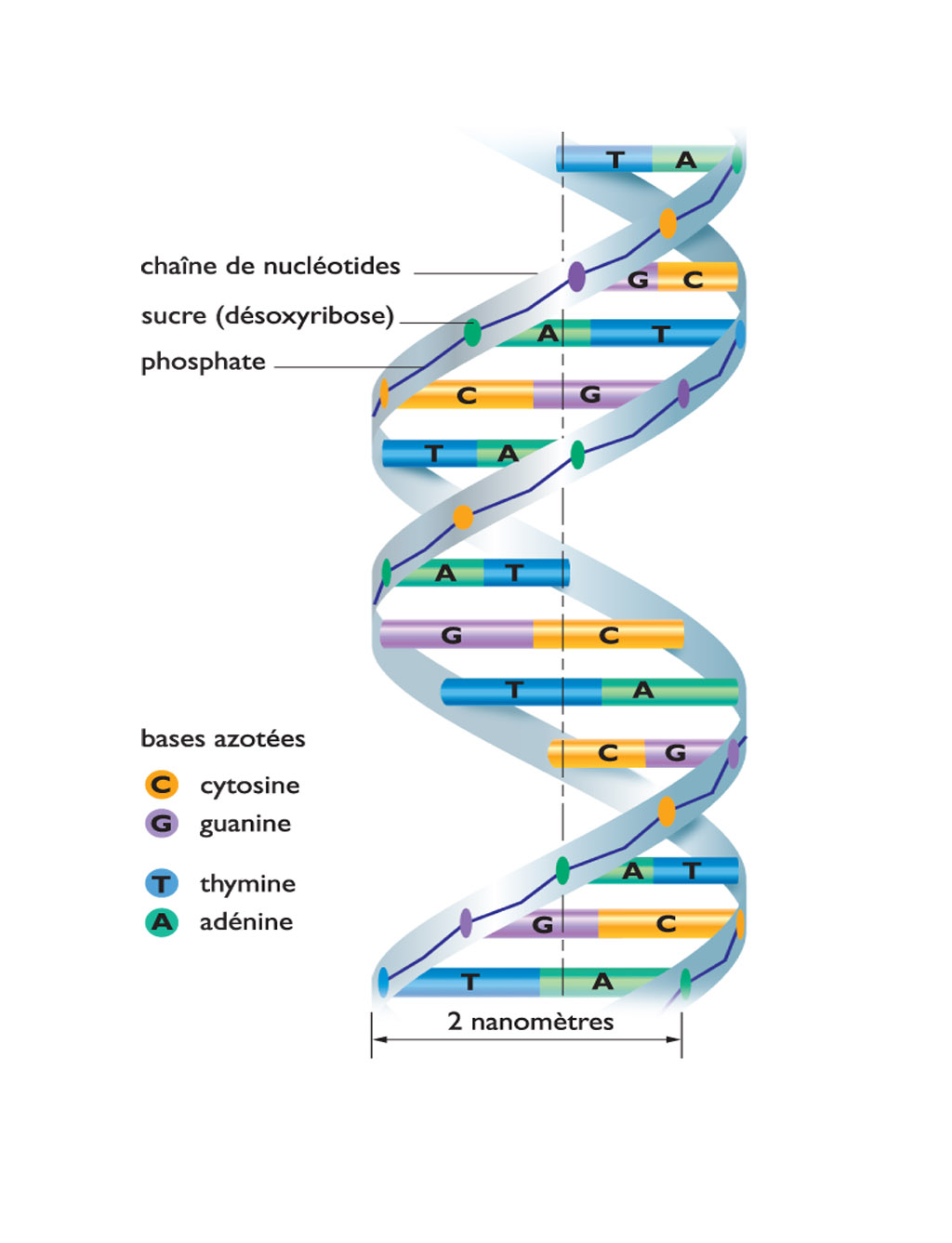 http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372
Chez certains virus (virus à ARN), l'information génétique est stockée dans des molécules d'ARN. Chez tous les autres organismes, depuis les virus à ADN jusqu'aux mammifères, dont l’homme, l'information génétique est stockée dans des molécules d'ADN. Chez les bactéries, l'ADN est présent sous forme d'un double brin unique, de forme circulaire, disposé à nu dans le cytoplasme (sans noyau). Dès que l'on s'élève dans l'échelle de l'évolution, le noyau s'individualise et contient plusieurs chromosomes qui stockent l'information génétique dans leur ADN."
"Partie de la biologie qui étudie les lois de l'hérédité.
Historique
Les Grecs, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avaient imaginé que certaines caractéristiques physiques des individus, appelées aujourd'hui caractères, se transmettaient des parents aux enfants. Mais il fallut attendre le milieu du 19ème siècle , avec les travaux du moine autrichien Johann Mendel, pour que les premières lois qui régissent la transmission héréditaire des caractères soient établies, en 1865.
Les découvertes de Mendel
Ces travaux consistaient à croiser des pois de couleurs et de formes différentes et à observer les caractéristiques des pois obtenus d'une génération à l'autre. Des observations de Mendel découlent deux des notions fondamentales de la génétique : d'une part, celle de phénotype (ensemble des caractères physiques et biologiques d'un individu) et de génotype (ensemble des caractères inscrits dans le patrimoine génétique d'un individu, qu'ils se traduisent ou non dans son phénotype) ; d'autre part, celle de caractère dominant (n'ayant besoin, pour se manifester chez un enfant, que d'être transmis par un seul des parents) et de caractère récessif (qui doit être transmis par le père et la mère pour se manifester chez l'enfant). Cependant, les lois de l'hérédité définies par Mendel tombèrent dans l'oubli et ne furent redécouvertes qu'au début du 20ème siècle.
L'avènement de la biologie moléculaire
Dans les années 1900 William Bateson, Carl Correns, Erich von Tschermak et Hugo de Vries redécouvrent les lois de l'hérédité de Mendel et contribuent à leur diffusion. Puis ce fut la découverte des gènes, de leur localisation sur les chromosomes, notamment grâce aux travaux de Thomas Morgan sur la drosophile (1915), des mutations génétiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty (1944) furent à l'origine de la génétique moléculaire en découvrant le rôle de l'ADN, dont la structure est établie aux débuts des années 1950 par les travaux de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, James Watson et Francis Crick ; la publication de Watson et Crick sur la structure en double hélice de l’ADN, qui marque la naissance de la génétique moléculaire, date de 1953.
Quelques années plus tard, François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff montrent l'existence de mécanismes régulateurs génétiques. Les années suivantes voient l'accès direct au gène que l'on peut désormais extraire et manipuler.
Les techniques apparues dans les années 1980 (notamment la PCR, → amplification génique) ont permis des progrès considérables. Le premier séquençage complet du génome d'un être vivant (une bactérie) a été réalisé en 1995, suivi l'année suivante par celui de la levure, premier eucaryote dont on ait décrypté la totalité des 6 100 gènes. Le projet Génome humain, initié en 1990, s’est terminé en 2003 : les trois milliards de bases (qui forment quelque 30 000 gènes) qui constituent le génome de l’espèce humaine ont été séquencées.
Le premier résultat important de la génétique des populations a été, en 1908, la découverte par un mathématicien britannique, Godfrey Hardy, et un biologiste allemand, Wilhelm Weinberg, de la loi (loi de Hardy-Weinberg) selon laquelle les fréquences des divers génotypes sont liées à celles des gènes et qui expose que, d'une génération à la suivante, l'équilibre se maintient.
Le trait le plus marquant de la génétique des populations depuis un quart de siècle est sans doute sa mathématisation croissante. Les recherches ont montré l'extrême polymorphisme des populations pour presque tous les caractères et que l'homogénéité des structures génétiques à laquelle on devrait théoriquement aboutir n'est pas atteinte. Le problème central de la génétique des populations reste celui de l'évolution du monde vivant.
Le support de l’information génétique
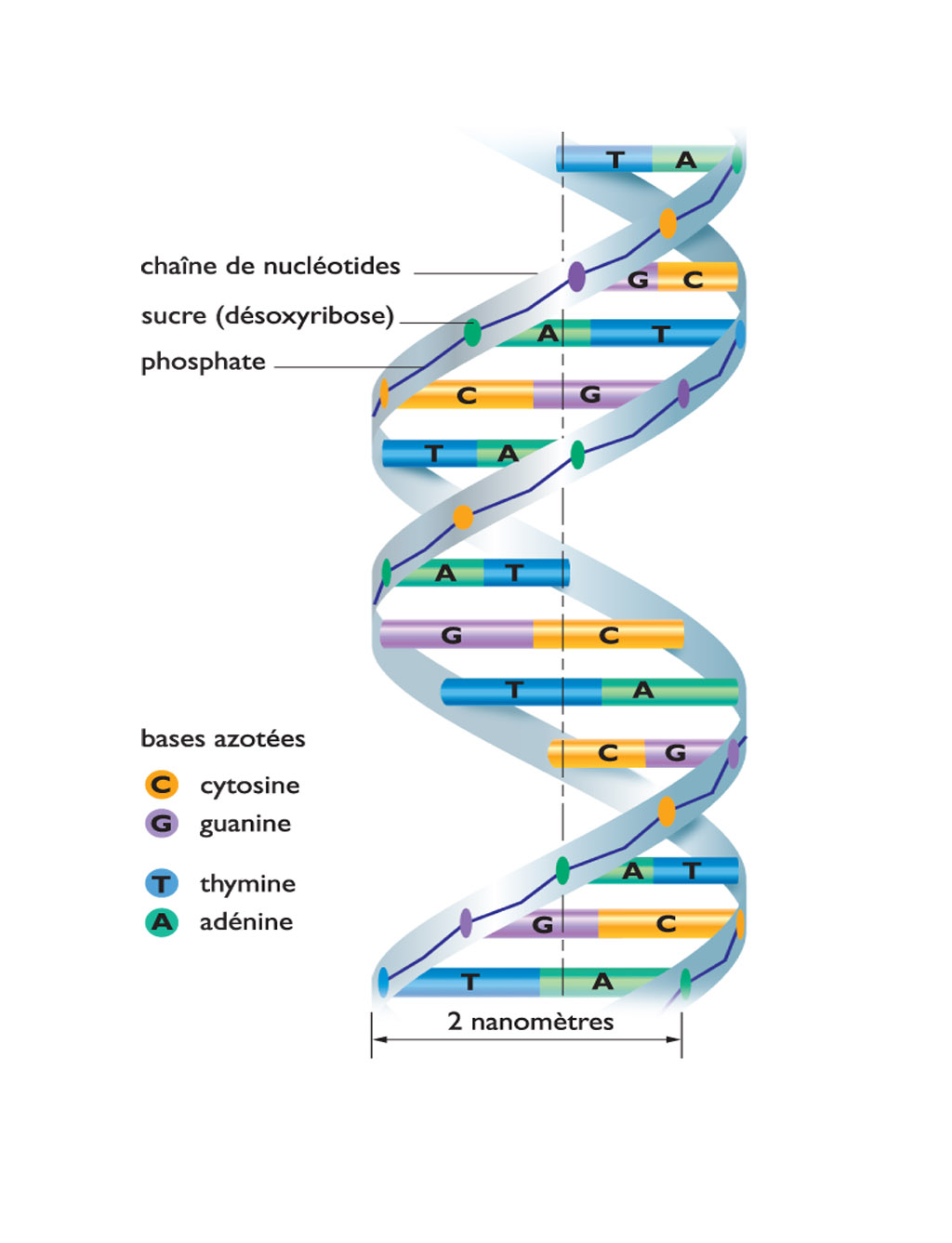 http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372 Chez certains virus (virus à ARN), l'information génétique est stockée dans des molécules d'ARN. Chez tous les autres organismes, depuis les virus à ADN jusqu'aux mammifères, dont l’homme, l'information génétique est stockée dans des molécules d'ADN. Chez les bactéries, l'ADN est présent sous forme d'un double brin unique, de forme circulaire, disposé à nu dans le cytoplasme (sans noyau). Dès que l'on s'élève dans l'échelle de l'évolution, le noyau s'individualise et contient plusieurs chromosomes qui stockent l'information génétique dans leur ADN."
- ultrafiltre2
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 3329
- Enregistré le : 09 mai15, 02:44
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 06 déc.16, 01:50merci Tiel pour ta réponse détaillée que je cite en totalitéTiel a écrit : "J'm'interroge" Je te détrompe, j'envisage bien la dérive génétique comme ce qui entraîne le résultat identifiable en termes comparatifs dont je parlais, sauf que pour distinguer les races, je ne considère que l'isolement génétique l'amenant qui est causé par un élément de culture.
Et c'est là que tu te plantes, déjà bonne chance pour déterminer quelle variation génétique a une cause culturelle, on ne parvient souvent même pas à affirmer si telle ou telle variation génétique a une origine sélective ou pourquoi elle a été sélectionné, et pour cause très souvent on ne peut pas. L'autre point est que vouloir définir des races qu'en prenant en compte les isolements et variations génétiques, causé par un élément culturel, revient à assoir son postérieur sur l'essentiel de la variabilité génétique différenciant différentes populations, d'origine purement aléatoire et sur laquelle la dérive génétique joue un rôle prépondérant.
"J'm'interroge" Comme je l'ai dit plus haut : pour ce qui est des facteurs naturels amenant à une dérive génétique et ou à une sélection naturelle, l'on possède déjà pour toute espèce [ y compris donc pour l'immense majorité de celles où la mémétique (l'équivalant chez les autres animaux de ce que l'on appelle "culture" chez l'Homme) ne joue pas, ou en tout cas pas de manière significative, ] un autre concept : celui de sous-espèces.
Sauf que le concept de sous-espèce est lui-même très imparfait, et certaines classifications en sous-espèces date et sont plus poursuivit par tradition que par réelle rigueur scientifique. Chez certaines espèces cette subdivision marche bien, chez d'autres c'est un bordel sans nom. Mais surtout si on pratique une subdivision en sous-espèces chez les animaux avec des critères scientifiques prenant en compte bien évidemment l'ensemble de la diversité génétique et phénotypique, alors les mêmes critères s'appliquent à l'homme, ce qui implique de prendre l'ensemble des variations génétiques et phénotypiques au sein de l'espèce humaine et non pas celles qui auraient été causer ou déterminer par de seuls raisons culturelles. Mais d'ailleurs combien de races humaines définis-tu? Ce serait bien que tu sois un minimum concret.
"J'm'interroge"Je distingue donc le concept de "race" de celui de "sous-espèces". Parce pour ce qui est des "races" (si elles existent bien) et des "sous-espèces" la cause n'est pas la même. Elle est culturelle ou mémétique pour les races (si elles existent bien) et simplement naturelle pour les sous-espèces.
Premièrement distinguer de manière aussi dichotomique culture et nature, ne tient pas, surtout si tu t'aventures dans le domaine de l'anthropologie. Deuxièmement tu ne peux pas séparer ainsi ces deux concepts, surtout pas chez l'homme où facteurs naturels et culturels se côtoient et parfois combinent et parfois même se confondent.
"J'm'interroge"J'ignore pourquoi tes définitions ne prennent pas en compte la simple dérive génétique (1). Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique.
Mais les critères de différenciations génétiques pour différencier telle ou telle populations reposent sur des éléments strictement biologiques. On ne sépare pas la variations génétiques qui aurait été sélectionné en raison de facteurs culturels du reste de la variation génétique.
"J'm'interroge"Je partage cet avis. Mais je l'ai déjà dit plus haut dans un autre post.
Non car tu prends une définition du mot «race» qui ne prendrait en compte que les différenciations génétiques d'origine culturelle.
"J'm'interroge"Je pense t'avoir répondu, mes définitions l'impliquent bien évidemment. As-tu une précision complémentaire à me demander à ce sujet ?
Oui des exemples qui montrent que la résultant en terme de diversité génétique chez les hommes est comparable à ce qu'on observe chez des animaux d'élevage comme les chiens. Et j'ai déjà la réponse, la réponse est non.
«Pour la diversité [celle des chiens], les résultats obtenus sont pratiquement à l'opposé de ceux qui se rapportent à l'espèce humaine. Bien que le nombre global de différences à l'intérieur de l'espèce, un peu moins d'une pour 1000 bases, soit comparable au cas humain, celles-ci apparaissent cette fois essentiellement entre les races. Chacune de ces dernières est en revanche extrêmement homogène.» Bertrand Jordan, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, Éditions du Seuil 2008
Bref cela confirme que la comparaison des populations humaines avec les races animales issues de l'élevage ne tient pas.
"J'm'interroge" En effet, d'où l'intérêt principal de la catégorie "race" car elle met en lien ce que j'appelle des éléments informationnels (monde II) et des processus naturels (monde I), comme la dérive génétique entre autre, mesurables et dont les résultats seraient facilement discernables in fine en termes de comparaisons de complexité de Kolmogorov (par exemple).
Non car les généticiens concrètement ont souvent déjà bien du mal à déterminer si telle ou telle variation génétique s'est répandue par sélection, et même si l'hypothèse sélective pour telle ou telle allèle est démontré souvent les raisons de cette sélection demeure inconnues. Le jour où tu aura un modèle mathématique qui permettra de distinguer tout cela tu auras peut-être un Prix Nobel et génétique, mais même dans cette hypothèse il n'y aurait aucune raison de faire des classifications raciales à partir des seuls variations génétiques qui ont été positivement sélectionner en raison de facteurs culturels et pas du reste de la variabilité génétique.
"J'm'interroge" La sélection humaine des reproducteurs dans les élevages d'animaux conduit à identifier ce que l'on appelle traditionnellement "races". La sélection s'opérant selon des choix humains (culturels), entre bien dans ma définition mais ne relèverait plus que du cas particulier.
L'exemple des chiens montre que cette analogie ne fonctionne pas. Et cela surtout que les humains n'opèrent pas des choix de manière systématiques à l'échelle du temps, les cultures changes, les flux de gènes puissant, et les facteurs naturelles épidémie et dérive génétiques, redistribuant les cartes avec une grosse part de la variabilité génétique qui ne se laissera jamais capturé par le modèle hypothétique que tu proposes.
"J'm'interroge"]Oui c'est un indice intéressant mais avec l'outil que je propose, l'on ne se base plus sur un seul type d'indice, l'on compare par exemple un nombre au choix d'allèles ou de caractéristiques phénotypiques. C'est l’algorithme et la puissance de calcul de l'ordinateur qui font le reste.
Les généticiens actuels utilisent déjà des ordinateurs, y compris pour l'indice Fst, et ils sont au courant de la complexité du génome et de distribution de la variabilité génétique, mais justement ils tiennent compte de l'ensemble de la variabilité génétique.
"J'm'interroge" L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).
Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.
"J'm'interroge" Ah non il n'est pas question de combiner de l'objectif et de l'informationnel ! D'ailleurs je ne vois pas comment l'on pourrait faire.
en ce que tu semble faire, et j'attends que tu sois plus précis et plus concret pour enfin déterminer où tu veux en venir.
"J'm'interroge" Par contre l'on peut très bien relier de l'objectif et de l'informationnel par des liens de nature mathématique. Comme l'a par exemple fait Shannon en liant mathématiquement son concept d'entropie, il ne l'a pas appelé ainsi pour rien, et celui d'information. En effet l'entropie de Shannon permet de donner un sens OBJECTIF en terme d'information à une valeur physique et inversement.
Ta présente comparaison ne clarifies absolument pas le modèle hypothétique que tu proposes.
"J'm'interroge" Dans mon cas il s'agit de faire un lien entre systèmes culturels et homogénies, entre arbres des filiations ou apparentements génétiques au sein de l'espèce humaine (biologie = base objective forte) et l'Histoire des peuples (éthnies) se fondant jusque là sur la recherche historique et l'archéologie (sciences humaines = base objective faible).
Les liens sont déjà fait depuis longtemps. Mais ça ne valide en rien ton hypothétique modèle.
"J'm'interroge"C'est ce que permettrait mon approche en fournissant à ces sciences humaines une base objective (biologique) solide susceptible de trancher entre certaines hypothèses formulées, de révéler la fausseté de certains de leurs modèles et de fournir de nombreuses pistes inédites.
Encore une fois cela fait un moment que la génétique est venu aider les sciences humaines et historiques pour confirmer, infirmer, ou mettre à l'épreuve diverses hypothèses. J'ai l'impression que tu as un sacré retard en la matière, problème cela ne valide en rien tout ce que tu avais dit plus haut et cela ne valide non-plus en rien une notion de race appliqué à l'espèce humaine.
"J'm'interroge"En effet, je prévois d'ailleurs que certains groupes dit ethniques revendiqués tels, n'en serait pas en vrai, si groupes ethniques et groupes raciaux doivent coïncider, ce que nous dira la recherche.
Déjà là tu te plantes un groupe ethnique et un groupe raciaux n'ont pas forcément à coïncider. Peut-importe qu'un descendant d'Africains de l'Est dont les parents ont émigré aux États-Unis il y a trente ans, se revendique comme Afro-Américain et que le regroupement Afro-Américain, compte des gens très éparses génétiquement, et ne forment pas un groupe génétiquement très cohérent, on peut défendre une ethnicité Afro-Américaine, sur des attribues purement culturels et identitaires. L'idée de filiation commune n'a même pas à être parfaitement avéré, à partir du moment qu'un ensemble d'individus cultive une culture, un sentiment fort d'appartenance à une identité culturelle commune, alors on peut parler d'ethnie, indépendamment de toute considération biologique. La génétique peut certes éclairer sur l'origine historique d'une ethnie, et sur sa filiation, mais elle ne définie pas en elle-même la réalité d'une ethnie au sens culturel et social du terme.
"J'm'interroge"Non je t'assure. Tout dépend de ce qui ressortira de la recherche que je propose en comparaison avec les données des sciences humaines sur les liens d'apparentement entre ethnies.
Ben non, car ce que tu proposes ne tiendra pas et part sur plusieurs présupposés erronées. Il serait bien que tu tentes d'être davantage concret pour te rendre compte des failles évidentes de ton hypothèse.
"J'm'interroge" S'il y aura manifestement bien des zones de coïncidences dans une proportion qui s'écartent de ce que prévoit le hasard, c'est que j'aurais tout bon.
Va falloir vraiment que tu sois plus concret pour donner un tant soit peu de crédibilité à ton hypothèse.
"J'm'interroge" Il y aura à peu près * autant de races que de points de congruence.
Vraiment soit plus concret.
"J'm'interroge" Non non, j'incluais tous les facteurs possibles qui entreraient en jeu suite à un isolement de nature culturelle quel qu'il soit.
Non tu privilégie les facteurs culturels d'ailleurs valider biologiquement parlant, la méthodologie que tu proposes.
"J'm'interroge" Que pourraient donc faire suite à des habitudes ou préférences alimentaires due à des interdictions ou prescription religieuses, une mise à l'écart d'individus pour x raisons dont religieuses, ........ , l'endogamie, la haine d'un autre peuples, que sais-je encore... ou une combinaison de tous ces facteurs possibles tous ce ramenant quand même principalement à de l'endogamie, ce qui favorise effectivement, évidemment, la dérive génétique.
La dérive génétique est permanente et l'endogamie culturellement favorisée n'est pas le seul facteur, la simple isolation géographique d'un nombre limité d'individus peut faire l'affaire.
"J'm'interroge dit " L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).
"Tiel répond " Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.
Oui il vaut mieux en effet : c'est important de comprendre qu'un modèle mathématique n'est valable dans une science que si celui qui l'utilise maîtrise la-dite science
merci pour ton humilité Tiel car tu connais bien ton sujet mais on ne te lis pas assez à mon goût pour apprécier ton sérieux
the sound - contact the fact l’hyper monde est un infty-simplexe triangulairement scalairisé
...ccnc ...et la lumière fut
...ccnc ...et la lumière fut
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 06 déc.16, 02:14Génétique (partie 2) encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/div ... ique/54999
L'expression génétique et son contrôle
"Parmi les protéines, acteurs essentiels de la vie cellulaire, les régulateurs de transcription sont chargés de moduler l'expression des gènes pour répondre aux besoins du moment de la cellule et de l'organisme. La détermination de la structure tridimensionnelle d'un certain nombre de complexes ADN-régulateur de transcription a permis de visualiser comment ces protéines reconnaissent sélectivement leurs sites de fixation sur l'ADN. Les principes gouvernant cette reconnaissance mutuelle commencent à être compris, sans qu'on puisse parler d'un code à proprement parler.
 http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)
Le contrôle de l'expression génétique
Le bon fonctionnement d'une cellule repose sur deux classes de macromolécules : les acides nucléiques (l'ADN, dépositaire de l'information génétique, et les ARN, impliqués dans la traduction de cette information) et les protéines (produits de la traduction de l'information). Les protéines présentent des activités variées : catalyse (enzymes), stockage de molécules (protéines de liaison), transport actif ou passif à travers les membranes (transporteurs, canaux), communications cellulaires (hormones peptidiques, récepteurs), architecture et mouvement (protéines du cytosquelette), reconnaissance du non-soi (anticorps)…
La relation universelle entre ces macromolécules s'exprime ainsi : toute protéine est codée par un gène, segment d'ADN constituant une unité fonctionnelle. Le nombre de gènes varie selon les organismes (de l'ordre de 2 500 chez les bactéries, 30 000 chez les mammifères). L'expression d'un gène aboutit à la synthèse d'une protéine spécifique. Chez les organismes pluricellulaires, toutes les cellules disposent du même stock de gènes, hérité d'une cellule initiale unique (l'œuf issu de la fécondation), et pourtant elles ne sont pas toutes identiques, parce qu'elles sont capables de synthétiser plus ou moins – voire pas du tout – les différentes protéines codées dans le génome, en fonction de leur type cellulaire et du stade de développement de l'organisme. Ainsi, l'hémoglobine est produite dans les précurseurs des globules rouges, les anticorps dans les lymphocytes B, l'actine et la myosine dans les cellules du muscle, la kératine dans celles de l'épiderme. Par ailleurs certaines protéines sont fabriquées uniquement au stade embryonnaire, les phénomènes de développement et de différenciation reposant sur l'expression différentielle d'un matériel génétique commun. De même, chez les organismes adultes, le cycle cellulaire fait appel au contrôle de l'expression des gènes. De nombreuses maladies, dont le cancer, les infections virales, les désordres immunitaires et les réactions allergiques, ainsi que les malformations au cours du développement embryonnaire, découlent de la production excessive ou insuffisante de certaines protéines. Le contrôle de l'expression génétique est effectué au niveau de la transcription de l'ADN par une famille de protéines, les régulateurs de transcription ; ceux-ci sont codés par les gènes régulateurs, qui pourraient représenter de 5 à 10 % du nombre total de gènes chez les eucaryotes supérieurs. Il apparaît que de nombreux désordres génétiques proviennent de mutations affectant les gènes régulateurs.
La transcription des gènes
L'ADN (acide désoxyribonucléique) est formé d'une suite linéaire de millions de nucléotides formés chacun de l'enchaînement d'un groupement phosphate et d'un sucre, le désoxyribose, portant une base pouvant être une adénine, une cytosine, une guanine ou une thymine (A, C, G ou T) ; l'information réside dans la suite des bases (la séquence nucléotidique). L'ADN comporte en réalité deux brins complémentaires de directions opposées enroulés l'un autour de l'autre (structure en double hélice élucidée par Watson et Crick en 1953). On peut la décrire comme un escalier en colimaçon, où les deux chaînes sucres-phosphates constituent les rampes, et les bases, tournées vers l'intérieur et se faisant face deux à deux, les marches. La complémentarité s'exprime par le fait qu'une adénine s'apparie toujours avec une thymine et une guanine toujours avec une cytosine (on ne trouve donc que des « marches » A-T, T-A, C-G ou G-C). Elle constitue le fondement non seulement de la perpétuation de l'information génétique (lors de la réplication), mais aussi de la transcription : la double hélice est alors juste déroulée transitoirement pour permettre à l'ARN polymérase de synthétiser selon les règles de l'appariement un brin d'ARN messager complémentaire du brin non codant, qui sert de matrice sur toute la région codante du gène considéré. L'ARN messager possède la même séquence que le brin codant d'ADN de départ, mais comporte des riboses au lieu des désoxyriboses et l'uracile (U) à la place de la thymine.
La question est de savoir ce qui détermine le début et la fin de la transcription par la polymérase. Pour le démarrage, des séquences signal, présentes au niveau du promoteur (partie du gène située en amont de la région codante), servent à positionner la polymérase. Chez les bactéries, les promoteurs contiennent très souvent la séquence TTGACA à 35 paires de bases et la séquence TATAAT à 10 paires de bases en amont du point de départ. Chez les eucaryotes, dans la très grande majorité des cas, la polymérase est positionnée par la fixation de la protéine TBP (en anglais, TATA-binding protein) à un court segment du promoteur contenant aussi la séquence TATA (la « boîte TATA »), mais situé cette fois à 25 paires de bases en amont du point de départ. Au point de départ proprement dit se trouve un autre élément de signalisation, le site initiateur, mais dont la séquence est beaucoup moins conservée. Une fois initiée, la transcription continue par élongation de l'ARN messager jusqu'au terminateur, situé juste après la région codante, et qui contient un signal de fin d'élongation.
La régulation de la transcription
Cette tâche est dévolue aux régulateurs de transcription, que l'on peut classer en deux grands groupes : les répresseurs et les activateurs. Chacun contrôle toute une catégorie de gènes possédant dans la région régulatrice une même séquence de reconnaissance à laquelle il se lie spécifiquement. Chez les bactéries, la régulation est souvent fondée sur la répression : un répresseur est fixé sur son site de liaison, l'opérateur, situé à proximité du promoteur, gênant ainsi la fixation de la polymérase. La répression est levée par la présence d'un inducteur dans le milieu, qui agit en dissociant le répresseur de l'opérateur, permettant à la transcription de démarrer.
La situation est beaucoup plus complexe chez les eucaryotes, où le niveau de transcription d'un gène résulte de l'interaction globale de l'ensemble des activateurs et répresseurs qui le contrôlent avec la machinerie transcriptionnelle. Les activateurs facilitent l'assemblage d'un complexe de préinitiation comprenant une dizaine d'entités multi-protéiques appelées « facteurs de transcription ». Les répresseurs empêchent l'ARN polymérase de démarrer la transcription, entre autres par compétition avec les facteurs de transcription ou les activateurs pour la liaison à l'ADN. La transcription de chaque gène est contrôlée spécifiquement, chacun étant régulé par une combinaison unique d'activateurs et de répresseurs.
De plus, chez les eucaryotes, l'ADN est stocké de manière très compacte au sein du noyau sous forme de fibre de chromatine, long chapelet de grains de forme cylindrique, les nucléosomes, constitués chacun d'un cœur de protéines basiques, les histones, autour duquel la double hélice est elle-même enroulée sur deux tours. Au sein de la chromatine, les facteurs de transcription et les protéines régulatrices n'ont pas accès aux séquences d'ADN qu'elles reconnaissent spécifiquement, ce qui constitue une manière basale de réprimer l'expression des gènes. Il faut l'intervention de protéines capables de remodeler la chromatine au niveau de ces sites régulateurs pour les rendre accessibles à la machinerie transcriptionnelle.
La reconnaissance de sites spécifiques de l'ADN
Comment les régulateurs de transcription reconnaissent-ils leurs gènes cibles au sein d'un génome qui en compte plus d'une centaine de milliers ? Des études de mutagenèse ont montré que chacune de ces protéines se lie à l'ADN, le plus souvent en amont de la partie codante des gènes dont elle contrôle l'expression, grâce à la présence d'une séquence d'une dizaine de paires de bases qui lui sert à la fois de site de reconnaissance spécifique et de point d'ancrage. Pour favoriser la formation du complexe ADN-protéine au niveau de la séquence correcte par rapport à toutes les autres, il faut une complémentarité structurale et une stabilisation énergétique, réalisée essentiellement au moyen de liaisons hydrogène et de Van der Waals. La mutation d'une seule paire de bases du site de liaison ou d'un seul aminoacide de la protéine peut suffire à diminuer considérablement l'association sélective des deux.
La double hélice présente, entre les deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre, un petit et un grand sillon ; le second, plus large, offrant un meilleur accès aux bases enfouies au cœur de la structure et un plus grand pouvoir discriminant entre les différentes paires de bases, est utilisé le plus souvent dans l'interaction avec la protéine. Dans de très nombreux cas, la protéine utilise un élément de sa propre structure, une hélice α : celle-ci va se loger dans le grand sillon à la manière d'une « tête de lecture », les chaînes latérales de certains aminoacides de l'hélice contactant directement les bases de la séquence cible. Cette « hélice de reconnaissance » fait toujours partie d'un motif structural (le « domaine de liaison ») permettant de la stabiliser et de renforcer l'association avec le bon segment d'ADN, en particulier grâce à des liaisons électrostatiques avec les groupements phosphates. Actuellement, une centaine de structures de complexes entre un domaine de liaison à l'ADN et un fragment d'ADN contenant la séquence reconnue ont été déterminées expérimentalement, essentiellement par cristallographie aux rayons X et dans quelques cas par résonance magnétique nucléaire. Il est apparu que les modes de reconnaissance étaient variés, en particulier qu'ils n'étaient pas limités aux hélices α, mais faisaient parfois intervenir des feuillets β (autre grand type d'élément de structure secondaire rencontré dans les protéines), et aussi le petit sillon de la double hélice plutôt que le grand sillon, comme dans le cas de la TBP. Différents motifs structuraux lient l'ADN, les plus fréquemment rencontrés étant l'« hélice-coude-hélice » et les « doigts de zinc ». Dans les seconds, des ions zinc servent à stabiliser la structure du domaine protéique par liaison à quatre aminoacides disséminés le long de la chaîne polypeptidique, des cystéines ou des histidines.
Un domaine de liaison à l'ADN reconnaît de 3 à 6 paires de bases, ce qui est trop court pour assurer la spécificité de la séquence cible. Pour résoudre ce problème, certains régulateurs de transcription contiennent plusieurs domaines de liaison à l'ADN, mais, le plus souvent, deux molécules de protéines s'associent pour former un dimère. Dans les deux cas, le site reconnu est plus long et la spécificité (discrimination) est donc accrue considérablement, mais l'autre avantage du dimère est l'augmentation importante de la force de liaison du complexe (affinité). Par ailleurs, la possibilité d'association en hétérodimère (deux protéines différentes) permet une combinatoire plus élevée qu'en homodimère et donc une régulation plus complexe.
Un autre facteur important dans la formation et la stabilisation des complexes ADN-protéine est la courbure de l'ADN. Celle-ci peut être intrinsèque (due à la séquence nucléotidique elle-même), ou bien encore induite par l'interaction avec la protéine. Dans ce cas, une adaptation mutuelle des deux partenaires permet d'optimiser leur association. Ainsi, le dimère de la protéine CAP catabolite activator protein coude la double hélice à plus de 90° pour s'y fixer plus facilement. La courbure de l'ADN est parfois essentielle à l'activité de la protéine ; ainsi, les activateurs de transcription pourraient agir en facilitant l'assemblage du complexe de préinitiation par le rapprochement de ses différents composants."
L'expression génétique et son contrôle
"Parmi les protéines, acteurs essentiels de la vie cellulaire, les régulateurs de transcription sont chargés de moduler l'expression des gènes pour répondre aux besoins du moment de la cellule et de l'organisme. La détermination de la structure tridimensionnelle d'un certain nombre de complexes ADN-régulateur de transcription a permis de visualiser comment ces protéines reconnaissent sélectivement leurs sites de fixation sur l'ADN. Les principes gouvernant cette reconnaissance mutuelle commencent à être compris, sans qu'on puisse parler d'un code à proprement parler.
 http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)Le contrôle de l'expression génétique
Le bon fonctionnement d'une cellule repose sur deux classes de macromolécules : les acides nucléiques (l'ADN, dépositaire de l'information génétique, et les ARN, impliqués dans la traduction de cette information) et les protéines (produits de la traduction de l'information). Les protéines présentent des activités variées : catalyse (enzymes), stockage de molécules (protéines de liaison), transport actif ou passif à travers les membranes (transporteurs, canaux), communications cellulaires (hormones peptidiques, récepteurs), architecture et mouvement (protéines du cytosquelette), reconnaissance du non-soi (anticorps)…
La relation universelle entre ces macromolécules s'exprime ainsi : toute protéine est codée par un gène, segment d'ADN constituant une unité fonctionnelle. Le nombre de gènes varie selon les organismes (de l'ordre de 2 500 chez les bactéries, 30 000 chez les mammifères). L'expression d'un gène aboutit à la synthèse d'une protéine spécifique. Chez les organismes pluricellulaires, toutes les cellules disposent du même stock de gènes, hérité d'une cellule initiale unique (l'œuf issu de la fécondation), et pourtant elles ne sont pas toutes identiques, parce qu'elles sont capables de synthétiser plus ou moins – voire pas du tout – les différentes protéines codées dans le génome, en fonction de leur type cellulaire et du stade de développement de l'organisme. Ainsi, l'hémoglobine est produite dans les précurseurs des globules rouges, les anticorps dans les lymphocytes B, l'actine et la myosine dans les cellules du muscle, la kératine dans celles de l'épiderme. Par ailleurs certaines protéines sont fabriquées uniquement au stade embryonnaire, les phénomènes de développement et de différenciation reposant sur l'expression différentielle d'un matériel génétique commun. De même, chez les organismes adultes, le cycle cellulaire fait appel au contrôle de l'expression des gènes. De nombreuses maladies, dont le cancer, les infections virales, les désordres immunitaires et les réactions allergiques, ainsi que les malformations au cours du développement embryonnaire, découlent de la production excessive ou insuffisante de certaines protéines. Le contrôle de l'expression génétique est effectué au niveau de la transcription de l'ADN par une famille de protéines, les régulateurs de transcription ; ceux-ci sont codés par les gènes régulateurs, qui pourraient représenter de 5 à 10 % du nombre total de gènes chez les eucaryotes supérieurs. Il apparaît que de nombreux désordres génétiques proviennent de mutations affectant les gènes régulateurs.
La transcription des gènes
L'ADN (acide désoxyribonucléique) est formé d'une suite linéaire de millions de nucléotides formés chacun de l'enchaînement d'un groupement phosphate et d'un sucre, le désoxyribose, portant une base pouvant être une adénine, une cytosine, une guanine ou une thymine (A, C, G ou T) ; l'information réside dans la suite des bases (la séquence nucléotidique). L'ADN comporte en réalité deux brins complémentaires de directions opposées enroulés l'un autour de l'autre (structure en double hélice élucidée par Watson et Crick en 1953). On peut la décrire comme un escalier en colimaçon, où les deux chaînes sucres-phosphates constituent les rampes, et les bases, tournées vers l'intérieur et se faisant face deux à deux, les marches. La complémentarité s'exprime par le fait qu'une adénine s'apparie toujours avec une thymine et une guanine toujours avec une cytosine (on ne trouve donc que des « marches » A-T, T-A, C-G ou G-C). Elle constitue le fondement non seulement de la perpétuation de l'information génétique (lors de la réplication), mais aussi de la transcription : la double hélice est alors juste déroulée transitoirement pour permettre à l'ARN polymérase de synthétiser selon les règles de l'appariement un brin d'ARN messager complémentaire du brin non codant, qui sert de matrice sur toute la région codante du gène considéré. L'ARN messager possède la même séquence que le brin codant d'ADN de départ, mais comporte des riboses au lieu des désoxyriboses et l'uracile (U) à la place de la thymine.
La question est de savoir ce qui détermine le début et la fin de la transcription par la polymérase. Pour le démarrage, des séquences signal, présentes au niveau du promoteur (partie du gène située en amont de la région codante), servent à positionner la polymérase. Chez les bactéries, les promoteurs contiennent très souvent la séquence TTGACA à 35 paires de bases et la séquence TATAAT à 10 paires de bases en amont du point de départ. Chez les eucaryotes, dans la très grande majorité des cas, la polymérase est positionnée par la fixation de la protéine TBP (en anglais, TATA-binding protein) à un court segment du promoteur contenant aussi la séquence TATA (la « boîte TATA »), mais situé cette fois à 25 paires de bases en amont du point de départ. Au point de départ proprement dit se trouve un autre élément de signalisation, le site initiateur, mais dont la séquence est beaucoup moins conservée. Une fois initiée, la transcription continue par élongation de l'ARN messager jusqu'au terminateur, situé juste après la région codante, et qui contient un signal de fin d'élongation.
La régulation de la transcription
Cette tâche est dévolue aux régulateurs de transcription, que l'on peut classer en deux grands groupes : les répresseurs et les activateurs. Chacun contrôle toute une catégorie de gènes possédant dans la région régulatrice une même séquence de reconnaissance à laquelle il se lie spécifiquement. Chez les bactéries, la régulation est souvent fondée sur la répression : un répresseur est fixé sur son site de liaison, l'opérateur, situé à proximité du promoteur, gênant ainsi la fixation de la polymérase. La répression est levée par la présence d'un inducteur dans le milieu, qui agit en dissociant le répresseur de l'opérateur, permettant à la transcription de démarrer.
La situation est beaucoup plus complexe chez les eucaryotes, où le niveau de transcription d'un gène résulte de l'interaction globale de l'ensemble des activateurs et répresseurs qui le contrôlent avec la machinerie transcriptionnelle. Les activateurs facilitent l'assemblage d'un complexe de préinitiation comprenant une dizaine d'entités multi-protéiques appelées « facteurs de transcription ». Les répresseurs empêchent l'ARN polymérase de démarrer la transcription, entre autres par compétition avec les facteurs de transcription ou les activateurs pour la liaison à l'ADN. La transcription de chaque gène est contrôlée spécifiquement, chacun étant régulé par une combinaison unique d'activateurs et de répresseurs.
De plus, chez les eucaryotes, l'ADN est stocké de manière très compacte au sein du noyau sous forme de fibre de chromatine, long chapelet de grains de forme cylindrique, les nucléosomes, constitués chacun d'un cœur de protéines basiques, les histones, autour duquel la double hélice est elle-même enroulée sur deux tours. Au sein de la chromatine, les facteurs de transcription et les protéines régulatrices n'ont pas accès aux séquences d'ADN qu'elles reconnaissent spécifiquement, ce qui constitue une manière basale de réprimer l'expression des gènes. Il faut l'intervention de protéines capables de remodeler la chromatine au niveau de ces sites régulateurs pour les rendre accessibles à la machinerie transcriptionnelle.
La reconnaissance de sites spécifiques de l'ADN
Comment les régulateurs de transcription reconnaissent-ils leurs gènes cibles au sein d'un génome qui en compte plus d'une centaine de milliers ? Des études de mutagenèse ont montré que chacune de ces protéines se lie à l'ADN, le plus souvent en amont de la partie codante des gènes dont elle contrôle l'expression, grâce à la présence d'une séquence d'une dizaine de paires de bases qui lui sert à la fois de site de reconnaissance spécifique et de point d'ancrage. Pour favoriser la formation du complexe ADN-protéine au niveau de la séquence correcte par rapport à toutes les autres, il faut une complémentarité structurale et une stabilisation énergétique, réalisée essentiellement au moyen de liaisons hydrogène et de Van der Waals. La mutation d'une seule paire de bases du site de liaison ou d'un seul aminoacide de la protéine peut suffire à diminuer considérablement l'association sélective des deux.
La double hélice présente, entre les deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre, un petit et un grand sillon ; le second, plus large, offrant un meilleur accès aux bases enfouies au cœur de la structure et un plus grand pouvoir discriminant entre les différentes paires de bases, est utilisé le plus souvent dans l'interaction avec la protéine. Dans de très nombreux cas, la protéine utilise un élément de sa propre structure, une hélice α : celle-ci va se loger dans le grand sillon à la manière d'une « tête de lecture », les chaînes latérales de certains aminoacides de l'hélice contactant directement les bases de la séquence cible. Cette « hélice de reconnaissance » fait toujours partie d'un motif structural (le « domaine de liaison ») permettant de la stabiliser et de renforcer l'association avec le bon segment d'ADN, en particulier grâce à des liaisons électrostatiques avec les groupements phosphates. Actuellement, une centaine de structures de complexes entre un domaine de liaison à l'ADN et un fragment d'ADN contenant la séquence reconnue ont été déterminées expérimentalement, essentiellement par cristallographie aux rayons X et dans quelques cas par résonance magnétique nucléaire. Il est apparu que les modes de reconnaissance étaient variés, en particulier qu'ils n'étaient pas limités aux hélices α, mais faisaient parfois intervenir des feuillets β (autre grand type d'élément de structure secondaire rencontré dans les protéines), et aussi le petit sillon de la double hélice plutôt que le grand sillon, comme dans le cas de la TBP. Différents motifs structuraux lient l'ADN, les plus fréquemment rencontrés étant l'« hélice-coude-hélice » et les « doigts de zinc ». Dans les seconds, des ions zinc servent à stabiliser la structure du domaine protéique par liaison à quatre aminoacides disséminés le long de la chaîne polypeptidique, des cystéines ou des histidines.
Un domaine de liaison à l'ADN reconnaît de 3 à 6 paires de bases, ce qui est trop court pour assurer la spécificité de la séquence cible. Pour résoudre ce problème, certains régulateurs de transcription contiennent plusieurs domaines de liaison à l'ADN, mais, le plus souvent, deux molécules de protéines s'associent pour former un dimère. Dans les deux cas, le site reconnu est plus long et la spécificité (discrimination) est donc accrue considérablement, mais l'autre avantage du dimère est l'augmentation importante de la force de liaison du complexe (affinité). Par ailleurs, la possibilité d'association en hétérodimère (deux protéines différentes) permet une combinatoire plus élevée qu'en homodimère et donc une régulation plus complexe.
Un autre facteur important dans la formation et la stabilisation des complexes ADN-protéine est la courbure de l'ADN. Celle-ci peut être intrinsèque (due à la séquence nucléotidique elle-même), ou bien encore induite par l'interaction avec la protéine. Dans ce cas, une adaptation mutuelle des deux partenaires permet d'optimiser leur association. Ainsi, le dimère de la protéine CAP catabolite activator protein coude la double hélice à plus de 90° pour s'y fixer plus facilement. La courbure de l'ADN est parfois essentielle à l'activité de la protéine ; ainsi, les activateurs de transcription pourraient agir en facilitant l'assemblage du complexe de préinitiation par le rapprochement de ses différents composants."
- J'm'interroge
- [ Incroyant ]
- [ Incroyant ]
- Messages : 12742
- Enregistré le : 02 sept.13, 23:33
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 06 déc.16, 08:28Je vais répondre à Tiel....ultrafiltre2 a écrit :JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie
Mais pour te répondre à toi : je dirais simplement que les mathématiques n'appartiennent pas aux seuls mathématiciens et qu'elles fournissent des outils très intéressants que les biologistes seraient bien bêtes de ne pas utiliser.
Et qui demande à un mathématicien de s'occuper de biologie ?
Je ne comprends donc pas bien le sens de ton intervention...
Ah ! Tout de même ! Content de te lire l'écrire !ultrafiltre2 a écrit :par contre (certes) rien n'interdit à quelqu'un qui connait bien la biologie de faire le choix lui même des objets mathématiques qui lui servent
Bien que je décèle là toutefois un paradoxe, puisque les biologistes ne sont pas forcément les mieux informés sur ce qui pourrait constituer pour eux un excellent outil mathématique ou algorithmique (je ne fais plus la différence).
Comment pourraient-ils en avoir connaissance puisque Biologie et Mathématique communiquent peu et que ceux parmi les mathématiciens qui s'occupent de ces outils, ne les voient pas forcément comme tels, ni ne les ont forcément pensés dans un sens qui devait intéresser la génétique, puisque souvent : ce qui les motive n'est que la recherche purement mathématique, donc non nécessairement appliquée à la recherche dans d'autres domaines tel que la Biologie.
Mais l'ADN (et l'ARN) sont des séquences de bases azotées, comportant* un code à 4 lettres :
Adénine (A)
Thymine (T)
Guanine (G)
Cytosine (C)
Avec parfois surtout chez les virus l'uracile (u) qui peut remplacer la thymine (T).
Donc quoi de plus semblable à un objet mathématique ?
* Note : je dis "comportant" j'ai souligné le mot, car tout l'ADN (ou ARN) n'est pas codant, mais peux importe ce n'est pas le point abordé ici.
Exemple 1) d'une portion de séquence d'ADN : ------------> http://education.expasy.org/bioinformat ... ome_21.jpg
Exemple 2) d'une comparaison d'une la même séquence chez différentes espèces de singes + le rat :

Et voici l'arbre phylogénétique qui en est tirée :

Or, ce type de donnée est précisément ce que peut analyser l'ordinateur avec de bons algorithmes inspirés de la recherche mathématique.
Injecter des centaines voire des milliers d'assortiments de séquençages aux choix* de dizaines ou de centaines d'allèles, voire même de portions d'ADN poubelle comme je l'ai expliqué plus haut, et avec sa puissance de calcul, plus le bon algorithme, (il y en a d'existants qui fonctionnent très bien) l’ordinateur nous donne la sortie un magnifique arbre phylogénétique basé sur les distances en termes de complexité de Kolmogorov qu'il suffira de comparer avec celui des différentes ethnies et parenté, reconstitué à partir des données des Sciences humaines.
* Note : pour leur choix l'on pourrait éventuellement demander aux généticiens lesquels seraient les plus judicieux, mais l'on pourrait tout aussi bien choisir c'est assortiment de portions au hasard, cela fonctionnerait aussi.
Non mais tu es libre d'exprimer ton avis.ultrafiltre2 a écrit :bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (désolé pour ma franchise)
______________
J'm'interroge a écrit :(1) Je te détrompe, j'envisage bien la dérive génétique comme ce qui entraîne le résultat identifiable en termes comparatifs dont je parlais, sauf que pour distinguer les races, je ne considère que l'isolement génétique l'amenant qui est causé par un élément de culture.
Je viens de comprendre pourquoi tu t'imagines que je me plantes.Tiel a écrit :Et c'est là que tu te plantes, déjà bonne chance pour déterminer quelle variation génétique a une cause culturelle, on ne parvient souvent même pas à affirmer si telle ou telle variation génétique a une origine sélective ou pourquoi elle a été sélectionné, et pour cause très souvent on ne peut pas.
Il ne s'agit pas dans ce que je propose d'identifier une variation génétique particulière identifiable qui serait dû à telle fréquence de gène muté ou autre observation particulière de ce genre, car en effet ce n'est pas directement ce que permet l'algorithme dont je parle.
Il ne permet en théorie que de dresser des distances évolutives plurifactorielles. C'est son point faible mais aussi son grand intérêt, puisqu'il nous dispense de tout cerner dans le détail en procédant par isolation, ce qui prend beaucoup de un temps.
Non pas du tout. Il n'a jamais été question d'ignorer cela. Tu m'as mal lu je crois, puisque je n'ai jamais été pour supprimer la catégorie : "sous-espèce" au contraire !Tiel a écrit :L'autre point est que vouloir définir des races qu'en prenant en compte les isolements et variations génétiques, causé par un élément culturel, revient à assoir son postérieur sur l'essentiel de la variabilité génétique différenciant différentes populations, d'origine purement aléatoire et sur laquelle la dérive génétique joue un rôle prépondérant.
Mais l'un des points est de savoir c'est vrai, si sous-espères et races comme je définis le mot se recoupent au point de former une seule et même réalité chez l'homme ou pas.
Ça je ne peux pas le dire, ni personne avant d'avoir comparé les deux.
Mais identifier la source de la variabilité (favorisant la dérive génétique ou autre) quand elle est culturelle, ce qui est possible en se servant des données des sciences humaines, permettrait de valider ou d'infirmer bien des hypothèses...
Mais ce n'est pas le présent sujet ici...
Ici, du moment qu'il est hypothétiquement possible de distinguer objectivement les causes de variabilité (par dérive génétique notamment) quand elles sont naturelles ou culturelles (culturelles ou plus généralement mémétiques) simplement par soustraction des groupes obtenus, hors congruence, il n'y a pas besoin d'argumenter plus.
J'm'interroge a écrit :Comme je l'ai dit plus haut : pour ce qui est des facteurs naturels amenant à une dérive génétique et ou à une sélection naturelle, l'on possède déjà pour toute espèce [ y compris donc pour l'immense majorité de celles où la mémétique (l'équivalant chez les autres animaux de ce que l'on appelle "culture" chez l'Homme) ne joue pas, ou en tout cas pas de manière significative, ] un autre concept : celui de sous-espèces.
Oui, je sais, mais c'est aussi ce que l'étude proposée permettrait de mieux mettre à jour. Car ce que je prévois c'est que les sous-espèces devraient normalement ressortir nettement et former une arborescence au sein de l'espèce, chez les espèces déjà où aucune culture ou mémétique ne joue.Tiel a écrit :Sauf que le concept de sous-espèce est lui-même très imparfait, et certaines classifications en sous-espèces date et sont plus poursuivit par tradition que par réelle rigueur scientifique.
Et la chez l'homme par si ma distinction fait sens, elles ressortiraient dans la deuxième étape évoquée : par recoupement avec les données des sciences humaines.
Je crois avoir répondu juste à l'instant.Tiel a écrit :Chez certaines espèces cette subdivision marche bien, chez d'autres c'est un bordel sans nom. Mais surtout si on pratique une subdivision en sous-espèces chez les animaux avec des critères scientifiques prenant en compte bien évidemment l'ensemble de la diversité génétique et phénotypique, alors les mêmes critères s'appliquent à l'homme, ce qui implique de prendre l'ensemble des variations génétiques et phénotypiques au sein de l'espèce humaine et non pas celles qui auraient été causer ou déterminer par de seuls raisons culturelles.
Je rajoute juste que l'arborescence que l'on aurait en résultat serait une donnée 100 % objective, à interpréter et à comparer ensuite avec les données des sciences humaines comme je l'ai dit, pour voir si le concept de race que je propose est pertinent ou pas et s'il ne faut que garder celui de sous-espèce en l'améliorant éventuellement, voire à lui donner aussi parfois parmi les facteurs concourant aux isolements génétiques qui y conduisent : un facteur culturel.
Un peu moins ou un peu plus que le nombre d'origines ethnico-géographiques.Tiel a écrit :Mais d'ailleurs combien de races humaines définis-tu? Ce serait bien que tu sois un minimum concret.
Ce que je peux dire par contre avec certitude, c'est que si la distinction que je fais entre "races" et "sous-espèces" chez les espèces où un facteur culturel joue (endogène ou exogène pour d'autres espèces animales) est pertinente, alors le nombre de "races" obtenu au sein d'une espèce, ne sera pas le même que le nombre de "sous-espèces" obtenues.
Si par exemple l'on découvrirait qu'il y à 3 groupes là où l'on n'attendait qu'un groupe formé de la race européenne par exemple, cela signifierait, si l'on doit bien sûr accorder un minimum de crédit aux sciences humaines, que la race européenne AURAIT DES CHANCES d'être constituée de trois sous-espèces.
(C'est un exemple fictif bien entendu mais selon moi possible...)
J'm'interroge a écrit :Je distingue donc le concept de "race" de celui de "sous-espèces". Parce pour ce qui est des "races" (si elles existent bien) et des "sous-espèces" la cause n'est pas la même. Elle est culturelle ou mémétique pour les races (si elles existent bien) et simplement naturelle pour les sous-espèces.
Attends, serais-tu en train de me dire que des interdits religieux comme par exemple celui de se reproduire avec des esclaves d'un autre groupe ethnique sont du même ordre et ont les mêmes effets que le fait être isolé sur un territoire entouré de mer suite à la progression d'un glacier quand ont ne dispose pas de moyens de navigation ?Tiel a écrit :Premièrement distinguer de manière aussi dichotomique culture et nature, ne tient pas, surtout si tu t'aventures dans le domaine de l'anthropologie. Deuxièmement tu ne peux pas séparer ainsi ces deux concepts, surtout pas chez l'homme où facteurs naturels et culturels se côtoient et parfois combinent et parfois même se confondent.
Je ne dis pas que là où des facteurs naturels jouent, les facteurs culturel ne jouent pas ni l'inverse non plus. Je dis qu'il peut y avoir des causes différentes par nature qui jouent ensembles, mais que ce n'est pas ce qui nous empêche de les identifier.
L'on peut facilement distinguer des causes même si ces causes sont en partie mêlées.
- Autrement dit : l'on peut-être objectif sans être contraint de se restreindre à l'analyse de caractéristiques ou de facteurs isolés. Ils est possible de tout analyser ensemble grâce à l'informatique aidée des mathématiques. Le résultat sera catégorique, bien qu'imprécis.
C'est la remarque que je faisais à Marco qui prétend que sans marqueur biologique de "race" (terme qui n'a pas de définition chez lui) l'on ne peut pas poser ce concept objectivement...
Je pense que c'est une grossière erreur et que cette position manque de logique, la race n'étant pas scientifiquement définie.
J'm'interroge a écrit :Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique.
En effet, les critères de différenciations naturels sont strictement biologique, tout-à-fait, mais la culture peut hypothétiquement jouer dessus.Tiel a écrit :Mais les critères de différenciations génétiques pour différencier telle ou telle populations reposent sur des éléments strictement biologiques.
Le facteur culturel devient à ce moment la cause, autrement dit : des considérations qui ne sont pas à proprement parler naturelles ou objectives, jouent OBJECTIVEMENT sur la nature.
Ce que je fais c'est de tenter de voir comment un lien entre culture et nature, s'il est réel, peut effectivement l'être.
Euh ? Est-ce un principe moral ?Tiel a écrit :On ne sépare pas la variations génétiques qui aurait été sélectionné en raison de facteurs culturels du reste de la variation génétique.
En vertu de quoi ne le ferait-on pas, du moment qu' OBJECTIVEMENT : la culture peut jouer sur la nature. Ce que de plus l'on pourrait assez facilement prouver comme je le prévois.
Tiel a écrit :Va falloir t'expliquer pourquoi parles-tu d'un isolement génétique qui serait du à un facteur culturel ou à une sélection humaine, sans mentionner les facteurs tels que la sélection naturelle en générale, c'est-à-dire pas forcément dû à des facteurs culturels (1), et surtout la dérive génétique qui agit de façon différentiel sur des population géographiquement séparée indépendamment de toute sélection ? Parce que bon comme exemple de pratique culturelle influent le génome des population on peut sortir l'exemple de la digestion du lactose à l'âge adulte, dont les facteurs génétiques ont été positivement sélectionner chez une majorité d'Européens ainsi que chez certains Africains, mais en terme de différenciation génétique c'est peau de balle par-apport à l'impact de la dérive génétiques, principales causes des écarts de terme de distances génétique. (2)
J'm'interroge a écrit :Je partage cet avis. Mais je l'ai déjà dit plus haut dans un autre post.
Ok. Oui, dans ce sens je ne serais peut-être pas de ton avis.Tiel a écrit :Non car tu prends une définition du mot «race» qui ne prendrait en compte que les différenciations génétiques d'origine culturelle.
Mais la définition que j'ai proposée de "race" ne prend bien en compte que les différenciations génétiques d'origines culturelles, en précisant que ces différenciations sont bien des processus naturels (dont la dérive génétique) conduisant à des populations objectivement discernables des autres par comparaison des complexités de Kolmogorov comme je l'ai dit.
Aurais-je l'impression de me répéter plus que de raison ?
Tiel a écrit :Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique
J'm'interroge a écrit :Je pense t'avoir répondu, mes définitions l'impliquent bien évidemment. As-tu une précision complémentaire à me demander à ce sujet ?
En effet la réponse est non, bien sûr, je n'ai jamais soutenu cela je crois, puisque les races de chiens sont issues de sélections humaines sur un terrain génétique différent. L'on ne pratique normalement chez nous que la sélection sexuelle, les modes esthétiques (culturelles) intervenant.Tiel a écrit :Oui des exemples qui montrent que la résultant en terme de diversité génétique chez les hommes est comparable à ce qu'on observe chez des animaux d'élevage comme les chiens. Et j'ai déjà la réponse, la réponse est non.
Les races humaines doivent être moins caractérisées, différenciées et variées et que ne le sont les races canines.
Des exemples, je n'en ai pas. Ce que je dis n'est que spéculatif, ce n'est qu'un ensemble d'hypothèses et de prévisions formulées dans la cohérence de ce que je comprends. J'ai fais des prévisions vérifiables, formulé des hypothèses et proposé un moyen vérifier le tout dans les faits.
Que demande le peuple ?
Que me reproche-ton ?
Ai-je parlé de comparer les races humaines et animales obtenues par sélections humaines ?Tiel a écrit :«Pour la diversité [celle des chiens], les résultats obtenus sont pratiquement à l'opposé de ceux qui se rapportent à l'espèce humaine. Bien que le nombre global de différences à l'intérieur de l'espèce, un peu moins d'une pour 1000 bases, soit comparable au cas humain, celles-ci apparaissent cette fois essentiellement entre les races. Chacune de ces dernières est en revanche extrêmement homogène.» Bertrand Jordan, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, Éditions du Seuil 2008
Bref cela confirme que la comparaison des populations humaines avec les races animales issues de l'élevage ne tient pas.
Je ne le crois pas.
Je sais bien que ce ne sont pas des choses strictement comparables étant donné que les mécanismes dominants favorisés dans le cas des chiens et de l'Homme ne sont pas les mêmes.
Il me semble que j'ai plutôt parlé de comparer l'arborescence trouvée à l'intérieur de l'espèce humaine par l'outil de comparaison des complexités de Kolmogorov génétiques et ou phénotypiques, à l'arbre des apparentements des ethnies humaines telle que reconstitué par les historiens, archéologues, anthropologues, linguistes, etc...
J'm'interroge a écrit :En effet, d'où l'intérêt principal de la catégorie "race" car elle met en lien ce que j'appelle des éléments informationnels (monde II) et des processus naturels (monde I), comme la dérive génétique entre autre, mesurables et dont les résultats seraient facilement discernables in fine en termes de comparaisons de complexité de Kolmogorov (par exemple).
(1) Ce sont des choses qu'il serait intéressant de connaître j'en conviens, mais qui ne sont pas indispensables pour déterminer s'il existe ou non des sous-espèces et races humaines (comme je les définis), combien il y en aurait et quelle serait leurs parentés.Tiel a écrit :Non car les généticiens concrètement ont souvent déjà bien du mal à déterminer si telle ou telle variation génétique s'est répandue par sélection, et même si l'hypothèse sélective pour telle ou telle allèle est démontré souvent les raisons de cette sélection demeure inconnues (1). Le jour où tu aura un modèle mathématique qui permettra de distinguer tout cela (2) tu auras peut-être un Prix Nobel et génétique, mais même dans cette hypothèse il n'y aurait aucune raison (3) de faire des classifications raciales à partir des seuls variations génétiques qui ont été positivement sélectionner en raison de facteurs culturels et pas du reste de la variabilité génétique.
(2) Bien.. cet outil existe, donc le prix Nobel sera peut-être pour le biologiste qui lira ces lignes et se renseignera un peu au niveau du département de mathématique de l'université où il travaille...
(3) C'est toi qui dis qu'il n'y a aucune raison. Moi je ne le sais pas s'il y en a une ou pas. Ce que je sais, c'est que le seul moyen assez facile à mettre en oeuvre pour le savoir, c'est celui que je dis ou un moyen qui lui ressemble.
Très humblement.
J'm'interroge a écrit :La sélection humaine des reproducteurs dans les élevages d'animaux conduit à identifier ce que l'on appelle traditionnellement "races". La sélection s'opérant selon des choix humains (culturels), entre bien dans ma définition mais ne relèverait plus que du cas particulier.
Pour les chiens en effet, ce sera plus difficile que pour l'Homme car l'on ne dispose sans doute pas d'assez de données sur les sélections réalisées et les caractéristiques recherchées. Par contre, contrairement à ce que tu crois peut-être : cet outil sera en mesure de fournir une arborescence très détaillée des différentes [races/sous-espèces] et apparentements entre [races/sous-espèces] de chiens.Tiel a écrit :L'exemple des chiens montre que cette analogie ne fonctionne pas. Et cela surtout que les humains n'opèrent pas des choix de manière systématiques à l'échelle du temps, les cultures changes, les flux de gènes puissant, et les facteurs naturelles épidémie et dérive génétiques, redistribuant les cartes avec une grosse part de la variabilité génétique qui ne se laissera jamais capturé par le modèle hypothétique que tu proposes.
La seule chose qu'il ne permettra pas dans un premier temps pour c'est de distinguer sous-espèces et races canines comme je définis ces termes.
J'm'interroge a écrit :Oui c'est un indice intéressant mais avec l'outil que je propose, l'on ne se base plus sur un seul type d'indice, l'on compare par exemple un nombre au choix d'allèles ou de caractéristiques phénotypiques. C'est l’algorithme et la puissance de calcul de l'ordinateur qui font le reste.
Oui mais par critère unique à chaque fois.... Qui plus est : par critère unique choisi entré au départTiel a écrit :Les généticiens actuels utilisent déjà des ordinateurs, y compris pour l'indice Fst, et ils sont au courant de la complexité du génome et de distribution de la variabilité génétique, mais justement ils tiennent compte de l'ensemble de la variabilité génétique.
Ce que je propose est différent.
J'm'interroge a écrit :L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).
On entre au hasard des caractéristiques d'individus, le plus grand nombre possibles par individus, toujours les mêmes caractéristiques par contre, et du plus grand nombre possible d'individus, sans excéder toutefois les possibilités de calcul de la machine. Cela peut être la couleurs des cheveux, la rapport de la taille de l’auriculaire à celle du majeur, l'écartement des yeux en rapport avec celui des orteils, je ne sais pas, je dis n'importe quoi exprès, la taille, le type de grain de peau, etc... tout ce qui se mesure ou peut se caractériser concernant des caractéristiques physiques (si l'on veut considérer des caractéristiques phénotypiques) et ou des séquences de génomes (prises au également hasard pourquoi pas) (si l'on veut considérer des caractéristiques génotypiques)... Des choses objectives en sommes qui représentnt la diversité au sein de l'espèce.Tiel a écrit :Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.
L'ordinateur (il faudra tout de même un supercalculateur...) traite ensuite ces données au moyen du bon algorithme, intégrant TOUS ces paramètres en même temps. -------------> C'est la grande différence.
Et au bout d'un certain temps de calcul, le résultat tombe : un arbre d'apparentements sans que soit nécessairement fourni de critère particulier cela dit, à chaque ramification, puisqu'il peut y en avoir une multitude qui jouent de façon mêlée.
En gros, c'est un arbre phylogénétique complet qui ressortirait et possiblement plus détaillé dans ses ramifications, puisqu'il y apparaîtrait même des ramifications aux sein des espèces, mais sans forcément les caractéristiques précises permettant de les distinguer.... Il faudrait le plus souvent les rechercher ensuite.
C'est le point noir, mais bon, l'on ne peut pas tout avoir non plus ! Il faut laisser du travail aux généticiens.
J'm'interroge a écrit :Ah non il n'est pas question de combiner de l'objectif et de l'informationnel ! D'ailleurs je ne vois pas comment l'on pourrait faire.
Je pense l'avoir été au moins un peu.Tiel a écrit :C'est pourtant bien ce que tu semble faire, et j'attends que tu sois plus précis et plus concret pour enfin déterminer où tu veux en venir.
J'm'interroge a écrit :Par contre l'on peut très bien relier de l'objectif et de l'informationnel par des liens de nature mathématique. Comme l'a par exemple fait Shannon en liant mathématiquement son concept d'entropie, il ne l'a pas appelé ainsi pour rien, et celui d'information. En effet l'entropie de Shannon permet de donner un sens OBJECTIF en terme d'information à une valeur physique et inversement.
Non mais elle répondait à ton objection qui était :Tiel a écrit :Ta présente comparaison ne clarifies absolument pas le modèle hypothétique que tu proposes.
- Tiel a écrit :Mais mêler cela à la culture, non, soit on parle de différenciation génétique, soit de différenciation culturelle, j'ai l'impression que tu veux faire du terme «races humaines» non pas un terme purement biologique, mais un terme qui combinerait des traits biologiques avec des traits culturels, ce qui ajoute encore davantage de confusion.
J'm'interroge a écrit :Dans mon cas il s'agit de faire un lien entre systèmes culturels et homogénies, entre arbres des filiations ou apparentements génétiques au sein de l'espèce humaine (biologie = base objective forte) et l'Histoire des peuples (éthnies) se fondant jusque là sur la recherche historique et l'archéologie (sciences humaines = base objective faible).
Je le sais bien, c'est pourquoi je dis depuis le début qu'il faut passer par l'analyse comparative algorithmique.Tiel a écrit :Les liens sont déjà fait depuis longtemps. Mais ça ne valide en rien ton hypothétique modèle.
J'm'interroge a écrit :C'est ce que permettrait mon approche en fournissant à ces sciences humaines une base objective (biologique) solide susceptible de trancher entre certaines hypothèses formulées, de révéler la fausseté de certains de leurs modèles et de fournir de nombreuses pistes inédites.
Non je sais bien que la génétique a déjà permis de très nombreuse fois de trancher de manière catégorique.Tiel a écrit :Encore une fois cela fait un moment que la génétique est venu aider les sciences humaines et historiques pour confirmer, infirmer, ou mettre à l'épreuve diverses hypothèses. J'ai l'impression que tu as un sacré retard en la matière...
Mais tu le dis toi-même :
Tu parles pour les méthodes en cours.Tiel a écrit :...problème cela ne valide en rien tout ce que tu avais dit plus haut et cela ne valide non-plus en rien une notion de race appliqué à l'espèce humaine.
Si je ne me trompes pas, le travail de comparaison algorithmique des séquence d'ADN permettra d'aller plus loin dans la connaissance des apparentements intra-spécifiques et aussi ce que je dis.
J'm'interroge a écrit :En effet, je prévois d'ailleurs que certains groupes dit ethniques revendiqués tels, n'en serait pas en vrai, si groupes ethniques et groupes raciaux doivent coïncider, ce que nous dira la recherche.
C'est exactement ce que je dis l'ami.... Attention à la Logique ! ! ! Je ne formule pas les choses n'importe comment...Tiel a écrit :Déjà là tu te plantes un groupe ethnique et un groupe raciaux n'ont pas forcément à coïncider.
"Afro-Americain" ne ressortira pas comme groupe, donc comme assimilable à "sous-espèce" ou "races" comme définis par moi. C'est encore une prévision hypothétique que je fais.Tiel a écrit :Peut-importe qu'un descendant d'Africains de l'Est dont les parents ont émigré aux États-Unis il y a trente ans, se revendique comme Afro-Américain et que le regroupement Afro-Américain, compte des gens très éparses génétiquement, et ne forment pas un groupe génétiquement très cohérent, on peut défendre une ethnicité Afro-Américaine, sur des attribues purement culturels et identitaires. L'idée de filiation commune n'a même pas à être parfaitement avéré, à partir du moment qu'un ensemble d'individus cultive une culture, un sentiment fort d'appartenance à une identité culturelle commune, alors on peut parler d'ethnie, indépendamment de toute considération biologique. La génétique peut certes éclairer sur l'origine historique d'une ethnie, et sur sa filiation, mais elle ne définie pas en elle-même la réalité d'une ethnie au sens culturel et social du terme.
Et "Afro-Américain" n'est pas ce qu'on peut classiquement appeler une ethnie, non. Je te conseille de demander l'avis d'un anthropologue.
J'm'interroge a écrit :Non je t'assure. Tout dépend de ce qui ressortira de la recherche que je propose en comparaison avec les données des sciences humaines sur les liens d'apparentement entre ethnies.
Ça c'est toi qui le dis.Tiel a écrit :Ben non, car ce que tu proposes ne tiendra pas et part sur plusieurs présupposés erronées.
La connaissance même objective n'est jamais concrète. Qu'entends-tu par "concret".Tiel a écrit :Il serait bien que tu tentes d'être davantage concret pour te rendre compte des failles évidentes de ton hypothèse.
J'm'interroge a écrit :S'il y aura manifestement bien des zones de coïncidences dans une proportion qui s'écartent de ce que prévoit le hasard, c'est que j'aurais tout bon.
J'ai étais je pense très clair, par contre je vois que tu ne m'as pas toujours bien lu.Tiel a écrit :Va falloir vraiment que tu sois plus concret pour donner un tant soit peu de crédibilité à ton hypothèse.
Mais si tu me demandes un éclaircissement sur un point précis, je me ferai cependant un plaisir de te répondre.
J'm'interroge a écrit :Il y aura à peu près * autant de races que de points de congruence.
J'ai expliqué ce point à plusieurs reprises :Tiel a écrit :Vraiment soit plus concret.
Je parle des résultats de la 2 ème étape du protocole proposé :
Après l'obtention (ou pas) en 1 ère étape, de l'arbre des apparentements intra-spécifiques par analyse comparative algorithmique des séquences d'ADN et ou des caractéristiques phénotypiques recensées, j'ai dit qu'il serait intéressant dans ce cas, de voir si mon concept de "race", non identique à celui de "sous-espèce" est pertinent ou pas, ou s'il ne fallait retenir que celui de "sous-espèce" (en l'améliorant toutefois). Car dans tous les cas : des ramifications intra-spécifiques démontreraient au moins la pertinence d'un concept de "sous-espèces".
J'ai déjà expliqué comment j'envisageais de voir si une distinction entre "race" (comme je la définis) et "sous-espèce" est pertinente : en comparant l'arbre des apparentements obtenu à l'étape 1, avec celui des ethnies reconstitué par différentes branches des sciences humaine.
Cela ne me semblait pas si difficile à comprendre...
J'm'interroge a écrit :Non non, j'incluais tous les facteurs possibles qui entreraient en jeu suite à un isolement de nature culturelle quel qu'il soit.
Tu ne me lis pas assez attentivement l'ami... Je n'aime pas beaucoup qu'on l'on me fasse dire n'importe quoi, comme si je l'aurais effectivement dit ou impliqué de mes propos quand ce n'est pas le cas.Tiel a écrit :Non tu privilégie les facteurs culturels d'ailleurs valider biologiquement parlant, la méthodologie que tu proposes.
J'm'interroge a écrit :Que pourraient donc faire suite à des habitudes ou préférences alimentaires due à des interdictions ou prescription religieuses, une mise à l'écart d'individus pour x raisons dont religieuses, ........ , l'endogamie, la haine d'un autre peuples, que sais-je encore... ou une combinaison de tous ces facteurs possibles tous ce ramenant quand même principalement à de l'endogamie, ce qui favorise effectivement, évidemment, la dérive génétique.
Ai-je sous-entendu le contraire ?Tiel a écrit :La dérive génétique est permanente et l'endogamie culturellement favorisée n'est pas le seul, facteur, la simple isolation géographique d'un nombre limité d'individus peut faire l'affaire.
_______________
Il n'est pas question de douter des compétences de ceux qui maîtrisent leur science, mais du fait qu'ils soient toujours en mesure de comprendre l'intérêt d'outils mathématiques qui pourraient être très utiles à leur science.ultrafiltre2 a écrit :"J'm'interroge dit " L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).
"Tiel répond " Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.
Oui il vaut mieux en effet : c'est important de comprendre qu'un modèle mathématique n'est valable dans une science que si celui qui l'utilise maîtrise la-dite science
- La réalité est toujours beaucoup plus riche et complexe que ce que l'on peut percevoir, se représenter, concevoir, croire ou comprendre.
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 06 déc.16, 10:59Bon je vais raccourcir ton pavé qui demeure largement décousu et encore plus incompréhensible et décousu que les précédents pour revenir aux points essentiels.

Une branche pour les Khoisan, une branche pour les populations Bantoue, une branche pour les Européens et ainsi de suite. Mais je t’explique plus bas pourquoi ce n’est pas réellement un arbre phylogénétique.
Lien direct vers la vidéo
Sérieusement j’ai l’impression que tu pars en vrille, encore une fois on ne pourra jamais déterminer les causes sélectives ou autres de la majeure partie de la variabilité génétique humaine.

Cache une réalité qui ressemble davantage à ceci.

Voir à ceci.

Plus d’informations sur le lien suivant
Car oui malgré des différences en terme de fréquences alléliques, et adaptatives entre les populations humaines, les flux de gènes régulières entre elles, font qu’on ne parvient à aucune subdivision claire et définitive, permettant de définir un réel arbre phylogénétique ou de réelles sous-espèce ou races. Et comme le modèle hypothétique que tu proposes est tellement mal-définie en plus de n’avoir aucun appuie dans une littérature scientifique qui étudie la variabilité génétique au sein de l’espèce humaine depuis plusieurs décennies, je vais en déduire que tu n’as rien à proposer, tant que tu n’apporteras rien de claire et d’un minimum concret.
Bref à moins que tu nies que les Afro-Américains se caractérise par ces perceptions d’expériences sociales et d’ascendances partagés, ce qui reviendrait à être malhonnête, je t’invite à bien te renseigner sur cette question car encore une fois on parle ici de phénomènes culturels et sociale et non pas de biologie.
Pour le reste tu navigue entre rétropédalage non-assumé, où tu affirmes avoir toujours tenu compte de la dérive génétique pour malgré tout affirmé la suprématie de tes variations d'origine culturels dans ton modèle hypothétique, rendant la position que tu défends aussi consistante que de la purée de pomme de terre mixé avec du lait. Je t'invite à te renseigner davantage sur la thématique que tu abordes et à faire de l'ordre dans tes idées et dans dans tes message.
Merci d'avance.
C’est quoi une distance évolutive plurifactorielle? Ce n’est que purement biologique (distance génétique, variations phénotypiques) où tu mélanges encore avec des facteurs culturels de manière à encore davantage embrouiller les choses? Et l’algorithme en question, tu l’as clairement définis et déjà appliqué à des données biologiques concrètes? Non parce que si tu veux je peux te parler de distances génétique et faire un arbre comme celui-ci.J'm'interroge a écrit :Il ne permet en théorie que de dresser des distances évolutives plurifactorielles. C'est son point faible mais aussi son grand intérêt, puisqu'il nous dispense de tout cerner dans le détail en procédant par isolation, ce qui prend beaucoup de un temps.

Une branche pour les Khoisan, une branche pour les populations Bantoue, une branche pour les Européens et ainsi de suite. Mais je t’explique plus bas pourquoi ce n’est pas réellement un arbre phylogénétique.
Mais on ne peut pas identifier les sources de la majeure partie de la variabilité génétique humaine, car nous n’avons pas de machine à remonter le temps. Par exemple tu définis une cinquantaine d’allèles dont le distribution en fréquence diffère chez les Français et les Camerounais, des allèles qui varient sur des séquences génétiques qui n’ont soient pas de fonctions connue, soient des fonctions partiellement connues (résistance à telle ou telle maladie, forme du nez, forme des yeux etc, etc…) comment tu définis la source sélective ou autre de la majeure partie ces variations remontant pour beaucoup à plusieurs dizaines de milliers d’années? Va falloir commencé à revenir dans le monde réel.J'm'interroge a écrit :Mais identifier la source de la variabilité (favorisant la dérive génétique ou autre) quand elle est culturelle, ce qui est possible en se servant des données des sciences humaines, permettrait de valider ou d'infirmer bien des hypothèses...
J'm'interroge a écrit :Ici, du moment qu'il est hypothétiquement possible de distinguer objectivement les causes de variabilité (par dérive génétique notamment) quand elles sont naturelles ou culturelles (culturelles ou plus généralement mémétiques) simplement par soustraction des groupes obtenus, hors congruence, il n'y a pas besoin d'argumenter plus.
Lien direct vers la vidéo
Sérieusement j’ai l’impression que tu pars en vrille, encore une fois on ne pourra jamais déterminer les causes sélectives ou autres de la majeure partie de la variabilité génétique humaine.
Ben non pour les chiens c’est plus facile justement, et tu as le culot de dire que je te lis mal, chez les chiens de race, la diversité génétique est très faible au sein d’une race, et se distribue majoritairement entre les races. Idem pour la variabilité phénotypique définis rigoureusement par les standards strictes pour définir une race. C’est pour cela que la notion de race chez les animaux d’élevage comme chez les chiens a toute sa pertinence.J'm'interroge a écrit :Pour les chiens en effet, ce sera plus difficile que pour l'Homme car l'on ne dispose sans doute pas d'assez de données sur les sélections réalisées et les caractéristiques recherchées.
Encore une fois tu as au moins vingt trains de retards car ça fait un moment que les généticiens font des arbres pour représentés les proximité génétiques entre les populations. Problème ces arbres ne sont pas des arbres phylogénétiques car factuellement un arbre représentant les distances génétiques comme ceci.J'm'interroge a écrit :En gros, c'est un arbre phylogénétique complet qui ressortirait et possiblement plus détaillé dans ses ramifications, puisqu'il y apparaîtrait même des ramifications aux sein des espèces, mais sans forcément les caractéristiques précises permettant de les distinguer.... Il faudrait le plus souvent les rechercher ensuite.

Cache une réalité qui ressemble davantage à ceci.

Voir à ceci.

Plus d’informations sur le lien suivant
Car oui malgré des différences en terme de fréquences alléliques, et adaptatives entre les populations humaines, les flux de gènes régulières entre elles, font qu’on ne parvient à aucune subdivision claire et définitive, permettant de définir un réel arbre phylogénétique ou de réelles sous-espèce ou races. Et comme le modèle hypothétique que tu proposes est tellement mal-définie en plus de n’avoir aucun appuie dans une littérature scientifique qui étudie la variabilité génétique au sein de l’espèce humaine depuis plusieurs décennies, je vais en déduire que tu n’as rien à proposer, tant que tu n’apporteras rien de claire et d’un minimum concret.
Non car ce qui définis les Afro-Américain c’est un sentiment identitaire et traits culturels communs avec l’idée d’une filiation commune. Preuve que tu ne parviens pas à distinguer ce qui est du domaine biologique, du domaine culturel et social et c’est bien là ton problème et explique probablement en bonne partie le caractère incompréhensible de tes hypothèses.J'm'interroge a écrit :"Afro-Americain" ne ressortira pas comme groupe, donc comme assimilable à "sous-espèce" ou "races" comme définis par moi. C'est encore une prévision hypothétique que je fais.
«In essence, an ethnic group is a named social category of people based on perceptions of shared social experience or ancestry.» PEOPLES, James / BAILEY, Garrick (2014), Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology, 10th, University of Tulsa : Cengage Learning, p.367J'm'interroge a écrit :Et "Afro-Américain" n'est pas ce qu'on peut classiquement appeler une ethnie, non. Je te conseille de demander l'avis d'un anthropologue.
Bref à moins que tu nies que les Afro-Américains se caractérise par ces perceptions d’expériences sociales et d’ascendances partagés, ce qui reviendrait à être malhonnête, je t’invite à bien te renseigner sur cette question car encore une fois on parle ici de phénomènes culturels et sociale et non pas de biologie.
Pour le reste tu navigue entre rétropédalage non-assumé, où tu affirmes avoir toujours tenu compte de la dérive génétique pour malgré tout affirmé la suprématie de tes variations d'origine culturels dans ton modèle hypothétique, rendant la position que tu défends aussi consistante que de la purée de pomme de terre mixé avec du lait. Je t'invite à te renseigner davantage sur la thématique que tu abordes et à faire de l'ordre dans tes idées et dans dans tes message.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Tiel le 06 déc.16, 12:08, modifié 2 fois.
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 06 déc.16, 11:11Génétique (partie 3) encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/div ... ique/54999
Le code génétique
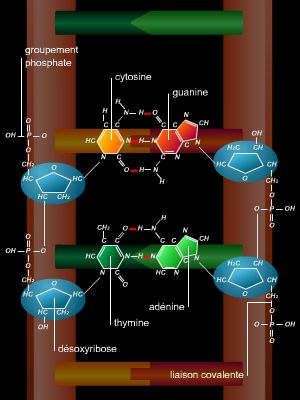 http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... es/1100039 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... es/1100039 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)
Le problème s'est alors posé de l'existence d'un code permettant d'énoncer simplement les règles de la reconnaissance de séquences spécifiques de l'ADN par des protéines, mais l'on s'est rapidement aperçu, à la lumière des structures connues de complexes ADN-protéine, qu'il n'existait pas de code universel simple, selon lequel par exemple une paire de bases serait toujours reconnue par le même aminoacide. C'est plutôt la multiplicité des agencements qui est de règle : une même paire de bases peut interagir avec différents aminoacides, voire plusieurs à la fois ; parfois, il n'y a aucun contact direct entre les bases qui déterminent la spécificité et la protéine, l'interaction étant médiée par des molécules d'eau fixées par le complexe ; enfin, dans les différents types de motifs de liaison utilisant une hélice de reconnaissance, celle-ci n'est pas orientée de la même façon par rapport au grand sillon. Néanmoins, pour chaque type de motif, on observe qu'une paire de bases donnée interagit plutôt avec certains aminoacides. La mise en évidence de telles préférences permet de prédire des interactions ADN-protéine, de changer la spécificité en mutant soit la protéine, soit la séquence d'ADN reconnue, et de concevoir des protéines artificielles capables de lier une séquence particulière d'ADN (cela a été réalisé très récemment par l'équipe de Carl Pabo aux États-Unis).
 http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... DN/1100150 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... DN/1100150 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)
Le code génétique, basé sur la correspondance entre les triplets de bases (codons) et les aminoacides, est un code de lecture (linéaire et séquentiel) qui ne doit donc permettre aucune équivoque. En revanche, la fixation de protéines à des séquences spécifiques d'ADN est un problème de reconnaissance de formes (donc en trois dimensions) qui peut donc comporter des solutions beaucoup plus nombreuses. Avec le temps, de plus en plus de nouvelles structures sont déterminées expérimentalement, mettant en évidence des arrangements originaux. La régulation de la transcription faisant appel à de multiples acteurs, la nature, comme souvent, a utilisé la diversité des solutions pour générer au cours de l'évolution ces réseaux d'interactions complexes. Leur connaissance détaillée permettra sans doute de combattre un certain nombre de maladies comme le cancer, les désordres immunitaires et les affections cardio-vasculaires en modulant la transcription de certains gènes. C'est déjà le cas des médicaments qui agissent sur les récepteurs hormonaux, comme le tamoxifène dans le traitement du cancer du sein et les anti-inflammatoires stéroïdiens."
Le code génétique
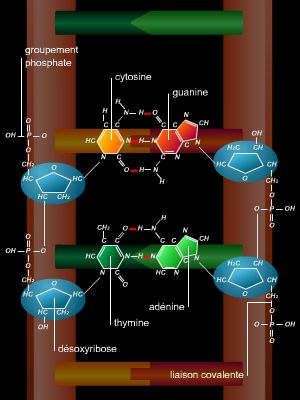 http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... es/1100039 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... es/1100039 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)Le problème s'est alors posé de l'existence d'un code permettant d'énoncer simplement les règles de la reconnaissance de séquences spécifiques de l'ADN par des protéines, mais l'on s'est rapidement aperçu, à la lumière des structures connues de complexes ADN-protéine, qu'il n'existait pas de code universel simple, selon lequel par exemple une paire de bases serait toujours reconnue par le même aminoacide. C'est plutôt la multiplicité des agencements qui est de règle : une même paire de bases peut interagir avec différents aminoacides, voire plusieurs à la fois ; parfois, il n'y a aucun contact direct entre les bases qui déterminent la spécificité et la protéine, l'interaction étant médiée par des molécules d'eau fixées par le complexe ; enfin, dans les différents types de motifs de liaison utilisant une hélice de reconnaissance, celle-ci n'est pas orientée de la même façon par rapport au grand sillon. Néanmoins, pour chaque type de motif, on observe qu'une paire de bases donnée interagit plutôt avec certains aminoacides. La mise en évidence de telles préférences permet de prédire des interactions ADN-protéine, de changer la spécificité en mutant soit la protéine, soit la séquence d'ADN reconnue, et de concevoir des protéines artificielles capables de lier une séquence particulière d'ADN (cela a été réalisé très récemment par l'équipe de Carl Pabo aux États-Unis).
 http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... DN/1100150 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... DN/1100150 (il y a une petite vidéo d'animation qui va avec)Le code génétique, basé sur la correspondance entre les triplets de bases (codons) et les aminoacides, est un code de lecture (linéaire et séquentiel) qui ne doit donc permettre aucune équivoque. En revanche, la fixation de protéines à des séquences spécifiques d'ADN est un problème de reconnaissance de formes (donc en trois dimensions) qui peut donc comporter des solutions beaucoup plus nombreuses. Avec le temps, de plus en plus de nouvelles structures sont déterminées expérimentalement, mettant en évidence des arrangements originaux. La régulation de la transcription faisant appel à de multiples acteurs, la nature, comme souvent, a utilisé la diversité des solutions pour générer au cours de l'évolution ces réseaux d'interactions complexes. Leur connaissance détaillée permettra sans doute de combattre un certain nombre de maladies comme le cancer, les désordres immunitaires et les affections cardio-vasculaires en modulant la transcription de certains gènes. C'est déjà le cas des médicaments qui agissent sur les récepteurs hormonaux, comme le tamoxifène dans le traitement du cancer du sein et les anti-inflammatoires stéroïdiens."
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 07 déc.16, 11:59Science encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/div ... ence/90594
"Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales.
Le mot science est ambigu. D'un côté, il sert à désigner la forme la plus haute de savoir et de connaissance humaine, celle qui ne peut être remise en question et qui possède la valeur de l'absolument vrai. De l'autre, il renvoie à des activités de production de connaissances bien identifiables dans les sociétés modernes parce qu'elles sont en liaison avec des institutions (universités, laboratoires, sociétés savantes, etc.), des investissements et des développements techniques qui, depuis la révolution industrielle du 19ème siècle ont peu à peu bouleversé notre vie quotidienne. Il n'est pas sûr que les différentes sciences puissent correspondre à une idée unique de la Science et que l'on puisse donner une fois pour toutes des critères de scientificité. Le phénomène scientifique doit être abordé par le biais de son développement historique et des réflexions qu'il suscite.
Les premières conceptions de la science
Dès l'origine de la philosophie occidentale (avec Platon, notamment), les philosophes se sont efforcés de définir la nature de la connaissance scientifique conçue comme l'aboutissement désintéressé de la vie cognitive humaine. La science doit d'abord rompre avec la perception, puisque la sensation est changeante et illusoire. Elle ne saurait se confondre avec l'opinion, puisque celle-ci, même lorsqu'elle est vraie, ne dispose ni d'un fondement solide, ni de la possibilité d'être transmise par la seule voie d'un discours rationnel.
Comme le formulera, avec vigueur, Aristote, la science est la connaissance démonstrative des causes, elle est nécessaire et universelle. Il n'y a donc de science que du général, ce qui signifie qu'elle doit être valable sans exceptions, quant à ses objets et pour tous les sujets. Il n'y a pas plus de science des individus qu'il n'y a de science individuelle.
Les philosophes ont longuement tenté d'aborder la question de la définition des sciences à partir de celle de leurs méthodes. Le problème essentiel était de distinguer l'activité scientifique d'autres activités proprement humaines comme sont l'art, la religion ou la stratégie politique. On parvient assez facilement à distinguer la science de l'art ou de la stratégie politique si l'on s'en tient à son statut de représentation exacte d'une réalité préexistante : l'art produit des objets et la stratégie politique vise à la conquête du pouvoir. Cette distinction repose, toutefois, sur une conception très étroite de la science qui en exclut les activités techniques et les relations entre les hommes. Cette conception n'est plus guère tenable aujourd'hui : non seulement les sciences de la nature (physique, chimie, biologie, etc.) sont l'une des principales sources de production des biens matériels, mais leur maîtrise et leur développement correspondent à des enjeux de pouvoir considérables (par exemple, en liaison avec les industries militaires).
Le problème du rapport à la religion est apparemment plus simple. Bien sûr, tout ce qui concerne l'aspect subjectif de cette dernière (l'adhésion individuelle, la foi et la croyance) est exclu par la méthodologie scientifique. Mais, on peut très bien concevoir une discipline qui aurait pour but d'atteindre par des procédures scientifiques le même objet que la religion. Cela a été conçu en Occident sous le nom de « théologie rationnelle » (science de Dieu). Ce n'est qu'à la fin du xviiie s. que E. Kant parvint à une critique décisive du caractère scientifique de la théologie. Ce but n'a pu être atteint qu'à la suite d'un important remaniement de l'idée même que l'on pouvait se faire de la science. Au lieu de la définir seulement par sa méthode, à la façon d'Aristote, il fallait préciser qu'il n'y a science que de ce qui peut faire l'objet de l'expérience partagée des hommes. La théologie – quelle que soit sa méthode – ne saurait donc être une science.
Caractère empirique et réfutation de la connaissance
L'insistance sur le rapport à un objet externe pour définir un principe de démarcation entre ce qui est de la science et ce qui ne l'est pas a conduit, au 20ème siècle, le philosophe K. Popper à placer cette démarcation dans une nouvelle définition du caractère empirique de notre connaissance scientifique du monde. Selon un modèle conçu au 19ème siècle – en plein triomphe des sciences expérimentales – par le physiologiste C. Bernard, une science expérimentale suppose trois étapes : la formulation d'une hypothèse ; puis, la construction d'un montage technique permettant de tester cette hypothèse ; enfin, le test proprement dit qui confirme ou infirme celle-ci. Popper a remarqué que, logiquement, on ne pouvait pas démontrer expérimentalement une proposition universelle : il faudrait vérifier tous les cas, ce qui est impossible, puisque l'universel concerne aussi ce qui aura lieu dans le futur. À l'inverse, un seul cas négatif suffit à rejeter de façon absolue une proposition universelle. Paradoxalement, seuls les résultats expérimentaux négatifs sont démonstratifs. De là l'idée que ce qui distingue la science de tout autre type de représentation, ce n'est pas la vérification mais la réfutation. II existe quantités de théories qui ne seront jamais réfutées par l'expérience, parce qu'elles sont trop vagues ou générales, comme les « prédictions » des astrologues qui sont toujours à peu près vraies quoi qu'il arrive. Ne sont scientifiques que les théories réfutables, c'est-à-dire celles pour lesquelles on peut au moins imaginer des conditions expérimentales plausibles qui les réfuteraient.
L'activité scientifique ne devrait donc pas se concevoir comme l'accumulation au cours du temps de vérités éternelles et le rejet des erreurs passées. Elle correspond plutôt à la répétition d'un double processus : d'abord l'invention et la formulation d'une théorie, puis la construction d'hypothèses et de moyens techniques permettant autant sa corroboration que l'éventualité de sa réfutation empirique. Ce rationalisme critique, comme on l'appelle, produit une conception de l'activité scientifique dans laquelle les théories ne sont jamais ni totalement prouvées, ni vraiment définitives. Par définition, et contrairement à l'antique opinion philosophique, nos sciences sont faillibles. Une telle conception laisse toutefois deux questions ouvertes.
L'extension de la notion de réfutabilité
Il est inexact d'admettre que, dans une activité scientifique quelconque, on ait simplement affaire à des propositions ou connaissances isolées soumises à des tests empiriques. En vérité, nous choisissons les hypothèses soumises aux tests. Nos théories comportent toutes des noyaux métaphysiques qui ne sont généralement pas soumis à l'expérience, parce que nous ne souhaitons pas les y soumettre et qu'au reste elles ne peuvent y être soumises directement. Ainsi, le concept de temps, interne à la mécanique classique, est le type même de noyau métaphysique que l'on répugne à changer : habituellement, lorsque l'on fait une expérience, on ne songe pas à tester un concept de cet ordre. Les théories sont des totalités dont nous isolons certains éléments. Mais, face à l'expérience, c'est toujours la théorie entière qui est véritablement en question. Parfois, lorsque nos théories sont en défaut nous pouvons nous contenter de changer certains éléments ; parfois, c'est toute la théorie qu'il faut changer. Il n'y a jamais de moyen mécanique qui permette à coup sûr de prendre la bonne décision.
Le rapport de la science à la notion de vérité
Selon la conception traditionnelle, une connaissance scientifique est vraie, par définition. On tendrait à en déduire qu'une hypothèse fausse n'est pas scientifique. En particulier, il faudrait conclure qu'une théorie que nous n'admettons plus aujourd'hui (par exemple, la théorie de Ptolémée, qui fait de la Terre le centre de l'Univers, avec un Soleil qui tourne autour d'elle, ou encore la biologie aristotélicienne, qui considère que les espèces vivantes sont fixes et éternelles) n'est pas scientifique. Pourtant, l'astronomie de Ptolémée et la biologie d'Aristote sont qualitativement bien différentes d'une conception mythique de l'Univers ou d'une conception créationniste des espèces vivantes telle qu'on la trouve, par exemple, dans l'Ancien Testament. Le rationalisme critique nous laisse démuni devant ce paradoxe. C'est parce qu'il repose sur une conception très abstraite de la science qui la réduit à n'être qu'un ensemble de propositions cohérentes et pourvues de valeurs de vérité. La réalité scientifique est autrement plus complexe.
Les sciences comme phénomènes sociaux
Les sciences sont, avant tout, des phénomènes sociaux que l'on peut appréhender à partir de trois composantes. Il y a d'abord, incontestablement, une composante théorique. Une science est un ensemble de connaissances, mais aussi de concepts, de protocoles expérimentaux, de savoir-faire techniques qui permettent de produire de nouvelles connaissances. Elle possède aussi une composante sociologique : il n'y a pas de science sans une organisation sociale des hommes qui peuvent la produire. Cela suppose une organisation de l'apprentissage, de la diffusion du savoir, de son contrôle et de sa reproduction. L'une des caractéristiques de la science moderne (depuis le 19ème siècle) a été un accroissement considérable de la masse du personnel spécialisé dans la production du savoir scientifique et, du même coup, celui des institutions organisant les carrières des travailleurs scientifiques (universités, instituts, etc.) ainsi que des modes de diffusion du savoir (livres, revues, bibliothèques, etc.). De nos jours, certains secteurs de la recherche ont atteint le stade de ce que l'on appelle la mégascience (« big science »). Les investissements destinés à la poursuite des expériences de physique des particules, à l'étude des climats par l'observation spatiale ou à la constitution de la carte du génome humain sont considérables : il faut former et embaucher un personnel important, construire des objets techniques très complexes (accélérateurs de particules comme le LHC, sondes spatiales, etc.), attendre des années pour obtenir des résultats. On comprend alors que toute science ait une troisième composante, la composante pratique, par quoi on peut désigner l'ensemble des intérêts qui font qu'une société poursuive dans telle ou telle direction la production de connaissances scientifiques.
L'éthique scientifique
Les sciences ne sauraient donc se réduire à des corps de propositions vraies, elles sont avant tout des réalités historiques et sociales destinées à produire certaines formes de connaissances. C'est leur histoire qui les distingue d'autres formes d'activités sociales comme sont les religions. On conçoit alors que des propositions fausses ou sans intérêt puissent figurer parmi les productions scientifiques. L'une des caractéristiques historiques des sciences est toutefois la constante rectification des connaissances produites. Les communautés scientifiques sont organisées selon une éthique stricte : la connaissance doit être publique, soumise aux processus de contrôle collectif, jamais admise comme définitive. Elles ont, bien entendu, leurs fraudeurs (vol d'informations, résultats expérimentaux falsifiés, etc.), mais dans le long terme ceux-ci se découvrent toujours. C'est par là que se distinguent les sciences et ce que l'on appelle, aujourd'hui, les pseudo-sciences. On voit, en effet, certains secteurs comme l'astrologie s'organiser socialement comme le sont la physique ou la biologie. Ils ont leurs centres de formation, leurs revues, leurs congrès, leurs écoles, leur histoire, etc. Mais jamais ces pseudo-sciences ne sont soumises au processus de contrôle critique collectif dans le long terme. Parce qu'elles appartiennent à un processus historique complexe, les véritables connaissances scientifiques ont toujours un double statut. D'un côté, elles doivent durer sous la critique : une connaissance scientifique qui changerait de contenu à chaque instant est impossible. De l'autre, leur destinée est d'être remplacées par d'autres connaissances : une connaissance qui durerait indéfiniment sous sa forme primitive serait un dogme et pas une connaissance scientifique. Même les noyaux de connaissance les plus stables et les plus anciens, comme le théorème de Thalès ou celui de Pythagore, ont pour destin d'être reformulés, réinterprétés et réinvestis dans d'autres structures théoriques."
"Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales.
Le mot science est ambigu. D'un côté, il sert à désigner la forme la plus haute de savoir et de connaissance humaine, celle qui ne peut être remise en question et qui possède la valeur de l'absolument vrai. De l'autre, il renvoie à des activités de production de connaissances bien identifiables dans les sociétés modernes parce qu'elles sont en liaison avec des institutions (universités, laboratoires, sociétés savantes, etc.), des investissements et des développements techniques qui, depuis la révolution industrielle du 19ème siècle ont peu à peu bouleversé notre vie quotidienne. Il n'est pas sûr que les différentes sciences puissent correspondre à une idée unique de la Science et que l'on puisse donner une fois pour toutes des critères de scientificité. Le phénomène scientifique doit être abordé par le biais de son développement historique et des réflexions qu'il suscite.
Les premières conceptions de la science
Dès l'origine de la philosophie occidentale (avec Platon, notamment), les philosophes se sont efforcés de définir la nature de la connaissance scientifique conçue comme l'aboutissement désintéressé de la vie cognitive humaine. La science doit d'abord rompre avec la perception, puisque la sensation est changeante et illusoire. Elle ne saurait se confondre avec l'opinion, puisque celle-ci, même lorsqu'elle est vraie, ne dispose ni d'un fondement solide, ni de la possibilité d'être transmise par la seule voie d'un discours rationnel.
Comme le formulera, avec vigueur, Aristote, la science est la connaissance démonstrative des causes, elle est nécessaire et universelle. Il n'y a donc de science que du général, ce qui signifie qu'elle doit être valable sans exceptions, quant à ses objets et pour tous les sujets. Il n'y a pas plus de science des individus qu'il n'y a de science individuelle.
Les philosophes ont longuement tenté d'aborder la question de la définition des sciences à partir de celle de leurs méthodes. Le problème essentiel était de distinguer l'activité scientifique d'autres activités proprement humaines comme sont l'art, la religion ou la stratégie politique. On parvient assez facilement à distinguer la science de l'art ou de la stratégie politique si l'on s'en tient à son statut de représentation exacte d'une réalité préexistante : l'art produit des objets et la stratégie politique vise à la conquête du pouvoir. Cette distinction repose, toutefois, sur une conception très étroite de la science qui en exclut les activités techniques et les relations entre les hommes. Cette conception n'est plus guère tenable aujourd'hui : non seulement les sciences de la nature (physique, chimie, biologie, etc.) sont l'une des principales sources de production des biens matériels, mais leur maîtrise et leur développement correspondent à des enjeux de pouvoir considérables (par exemple, en liaison avec les industries militaires).
Le problème du rapport à la religion est apparemment plus simple. Bien sûr, tout ce qui concerne l'aspect subjectif de cette dernière (l'adhésion individuelle, la foi et la croyance) est exclu par la méthodologie scientifique. Mais, on peut très bien concevoir une discipline qui aurait pour but d'atteindre par des procédures scientifiques le même objet que la religion. Cela a été conçu en Occident sous le nom de « théologie rationnelle » (science de Dieu). Ce n'est qu'à la fin du xviiie s. que E. Kant parvint à une critique décisive du caractère scientifique de la théologie. Ce but n'a pu être atteint qu'à la suite d'un important remaniement de l'idée même que l'on pouvait se faire de la science. Au lieu de la définir seulement par sa méthode, à la façon d'Aristote, il fallait préciser qu'il n'y a science que de ce qui peut faire l'objet de l'expérience partagée des hommes. La théologie – quelle que soit sa méthode – ne saurait donc être une science.
Caractère empirique et réfutation de la connaissance
L'insistance sur le rapport à un objet externe pour définir un principe de démarcation entre ce qui est de la science et ce qui ne l'est pas a conduit, au 20ème siècle, le philosophe K. Popper à placer cette démarcation dans une nouvelle définition du caractère empirique de notre connaissance scientifique du monde. Selon un modèle conçu au 19ème siècle – en plein triomphe des sciences expérimentales – par le physiologiste C. Bernard, une science expérimentale suppose trois étapes : la formulation d'une hypothèse ; puis, la construction d'un montage technique permettant de tester cette hypothèse ; enfin, le test proprement dit qui confirme ou infirme celle-ci. Popper a remarqué que, logiquement, on ne pouvait pas démontrer expérimentalement une proposition universelle : il faudrait vérifier tous les cas, ce qui est impossible, puisque l'universel concerne aussi ce qui aura lieu dans le futur. À l'inverse, un seul cas négatif suffit à rejeter de façon absolue une proposition universelle. Paradoxalement, seuls les résultats expérimentaux négatifs sont démonstratifs. De là l'idée que ce qui distingue la science de tout autre type de représentation, ce n'est pas la vérification mais la réfutation. II existe quantités de théories qui ne seront jamais réfutées par l'expérience, parce qu'elles sont trop vagues ou générales, comme les « prédictions » des astrologues qui sont toujours à peu près vraies quoi qu'il arrive. Ne sont scientifiques que les théories réfutables, c'est-à-dire celles pour lesquelles on peut au moins imaginer des conditions expérimentales plausibles qui les réfuteraient.
L'activité scientifique ne devrait donc pas se concevoir comme l'accumulation au cours du temps de vérités éternelles et le rejet des erreurs passées. Elle correspond plutôt à la répétition d'un double processus : d'abord l'invention et la formulation d'une théorie, puis la construction d'hypothèses et de moyens techniques permettant autant sa corroboration que l'éventualité de sa réfutation empirique. Ce rationalisme critique, comme on l'appelle, produit une conception de l'activité scientifique dans laquelle les théories ne sont jamais ni totalement prouvées, ni vraiment définitives. Par définition, et contrairement à l'antique opinion philosophique, nos sciences sont faillibles. Une telle conception laisse toutefois deux questions ouvertes.
L'extension de la notion de réfutabilité
Il est inexact d'admettre que, dans une activité scientifique quelconque, on ait simplement affaire à des propositions ou connaissances isolées soumises à des tests empiriques. En vérité, nous choisissons les hypothèses soumises aux tests. Nos théories comportent toutes des noyaux métaphysiques qui ne sont généralement pas soumis à l'expérience, parce que nous ne souhaitons pas les y soumettre et qu'au reste elles ne peuvent y être soumises directement. Ainsi, le concept de temps, interne à la mécanique classique, est le type même de noyau métaphysique que l'on répugne à changer : habituellement, lorsque l'on fait une expérience, on ne songe pas à tester un concept de cet ordre. Les théories sont des totalités dont nous isolons certains éléments. Mais, face à l'expérience, c'est toujours la théorie entière qui est véritablement en question. Parfois, lorsque nos théories sont en défaut nous pouvons nous contenter de changer certains éléments ; parfois, c'est toute la théorie qu'il faut changer. Il n'y a jamais de moyen mécanique qui permette à coup sûr de prendre la bonne décision.
Le rapport de la science à la notion de vérité
Selon la conception traditionnelle, une connaissance scientifique est vraie, par définition. On tendrait à en déduire qu'une hypothèse fausse n'est pas scientifique. En particulier, il faudrait conclure qu'une théorie que nous n'admettons plus aujourd'hui (par exemple, la théorie de Ptolémée, qui fait de la Terre le centre de l'Univers, avec un Soleil qui tourne autour d'elle, ou encore la biologie aristotélicienne, qui considère que les espèces vivantes sont fixes et éternelles) n'est pas scientifique. Pourtant, l'astronomie de Ptolémée et la biologie d'Aristote sont qualitativement bien différentes d'une conception mythique de l'Univers ou d'une conception créationniste des espèces vivantes telle qu'on la trouve, par exemple, dans l'Ancien Testament. Le rationalisme critique nous laisse démuni devant ce paradoxe. C'est parce qu'il repose sur une conception très abstraite de la science qui la réduit à n'être qu'un ensemble de propositions cohérentes et pourvues de valeurs de vérité. La réalité scientifique est autrement plus complexe.
Les sciences comme phénomènes sociaux
Les sciences sont, avant tout, des phénomènes sociaux que l'on peut appréhender à partir de trois composantes. Il y a d'abord, incontestablement, une composante théorique. Une science est un ensemble de connaissances, mais aussi de concepts, de protocoles expérimentaux, de savoir-faire techniques qui permettent de produire de nouvelles connaissances. Elle possède aussi une composante sociologique : il n'y a pas de science sans une organisation sociale des hommes qui peuvent la produire. Cela suppose une organisation de l'apprentissage, de la diffusion du savoir, de son contrôle et de sa reproduction. L'une des caractéristiques de la science moderne (depuis le 19ème siècle) a été un accroissement considérable de la masse du personnel spécialisé dans la production du savoir scientifique et, du même coup, celui des institutions organisant les carrières des travailleurs scientifiques (universités, instituts, etc.) ainsi que des modes de diffusion du savoir (livres, revues, bibliothèques, etc.). De nos jours, certains secteurs de la recherche ont atteint le stade de ce que l'on appelle la mégascience (« big science »). Les investissements destinés à la poursuite des expériences de physique des particules, à l'étude des climats par l'observation spatiale ou à la constitution de la carte du génome humain sont considérables : il faut former et embaucher un personnel important, construire des objets techniques très complexes (accélérateurs de particules comme le LHC, sondes spatiales, etc.), attendre des années pour obtenir des résultats. On comprend alors que toute science ait une troisième composante, la composante pratique, par quoi on peut désigner l'ensemble des intérêts qui font qu'une société poursuive dans telle ou telle direction la production de connaissances scientifiques.
L'éthique scientifique
Les sciences ne sauraient donc se réduire à des corps de propositions vraies, elles sont avant tout des réalités historiques et sociales destinées à produire certaines formes de connaissances. C'est leur histoire qui les distingue d'autres formes d'activités sociales comme sont les religions. On conçoit alors que des propositions fausses ou sans intérêt puissent figurer parmi les productions scientifiques. L'une des caractéristiques historiques des sciences est toutefois la constante rectification des connaissances produites. Les communautés scientifiques sont organisées selon une éthique stricte : la connaissance doit être publique, soumise aux processus de contrôle collectif, jamais admise comme définitive. Elles ont, bien entendu, leurs fraudeurs (vol d'informations, résultats expérimentaux falsifiés, etc.), mais dans le long terme ceux-ci se découvrent toujours. C'est par là que se distinguent les sciences et ce que l'on appelle, aujourd'hui, les pseudo-sciences. On voit, en effet, certains secteurs comme l'astrologie s'organiser socialement comme le sont la physique ou la biologie. Ils ont leurs centres de formation, leurs revues, leurs congrès, leurs écoles, leur histoire, etc. Mais jamais ces pseudo-sciences ne sont soumises au processus de contrôle critique collectif dans le long terme. Parce qu'elles appartiennent à un processus historique complexe, les véritables connaissances scientifiques ont toujours un double statut. D'un côté, elles doivent durer sous la critique : une connaissance scientifique qui changerait de contenu à chaque instant est impossible. De l'autre, leur destinée est d'être remplacées par d'autres connaissances : une connaissance qui durerait indéfiniment sous sa forme primitive serait un dogme et pas une connaissance scientifique. Même les noyaux de connaissance les plus stables et les plus anciens, comme le théorème de Thalès ou celui de Pythagore, ont pour destin d'être reformulés, réinterprétés et réinvestis dans d'autres structures théoriques."
- J'm'interroge
- [ Incroyant ]
- [ Incroyant ]
- Messages : 12742
- Enregistré le : 02 sept.13, 23:33
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 08 déc.16, 10:52Décousu pour quelqu'un qui extrapole et interprète mal les propos de son interlocuteur, ne faisant pas l'effort de lecture et de réflexion requis.Tiel a écrit :Bon je vais raccourcir ton pavé qui demeure largement décousu et encore plus incompréhensible et décousu que les précédents pour revenir aux points essentiels.
J'm'interroge a écrit :Il ne permet en théorie que de dresser des distances évolutives plurifactorielles. C'est son point faible mais aussi son grand intérêt, puisqu'il nous dispense de tout cerner dans le détail en procédant par isolation, ce qui prend beaucoup de un temps.
Je ne mélange rien, c'est toi qui t'embrouilles.Tiel a écrit :C’est quoi une distance évolutive plurifactorielle? Ce n’est que purement biologique (distance génétique, variations phénotypiques) où tu mélanges encore avec des facteurs culturels de manière à encore davantage embrouiller les choses?
Tu t'attaques à des choses que je n'ai pas impliquées dans mes propos l'ami.Tiel a écrit :Et l’algorithme en question, tu l’as clairement définis et déjà appliqué à des données biologiques concrètes? Non parce que si tu veux je peux te parler de distances génétique et faire un arbre comme celui-ci.
Une branche pour les Khoisan, une branche pour les populations Bantoue, une branche pour les Européens et ainsi de suite. Mais je t’explique plus bas pourquoi ce n’est pas réellement un arbre phylogénétique.
J'm'interroge a écrit :Mais identifier la source de la variabilité (favorisant la dérive génétique ou autre) quand elle est culturelle, ce qui est possible en se servant des données des sciences humaines, permettrait de valider ou d'infirmer bien des hypothèses...
Vrai et FauxTiel a écrit :Mais on ne peut pas identifier les sources de la majeure partie de la variabilité génétique humaine, car nous n’avons pas de machine à remonter le temps.
Vrai, nous ne pouvons effectivement pas identifier les sources de la majeure partie de la variabilité génétique humaine, mais ça c'est aussi ce que j'ai dit plusieurs fois si tu me lisais mieux. J'ai même dit que l'outil que je propose ne le pourrait pas non plus.
et
Faux, nous disposons bien d' "une machine à remonter le temps" qui permet de reconnaître les chemins empruntés par l'évolution.
J'ai déjà répondu à cette question, mais vu la qualité de l'écoute, je ne me répéterai pas.Tiel a écrit :Par exemple tu définis une cinquantaine d’allèles dont le distribution en fréquence diffère chez les Français et les Camerounais, des allèles qui varient sur des séquences génétiques qui n’ont soient pas de fonctions connue, soient des fonctions partiellement connues (résistance à telle ou telle maladie, forme du nez, forme des yeux etc, etc…) comment tu définis la source sélective ou autre de la majeure partie ces variations remontant pour beaucoup à plusieurs dizaines de milliers d’années? Va falloir commencé à revenir dans le monde réel.
J'm'interroge a écrit :Ici, du moment qu'il est hypothétiquement possible de distinguer objectivement les causes de variabilité (par dérive génétique notamment) quand elles sont naturelles ou culturelles (culturelles ou plus généralement mémétiques) simplement par soustraction des groupes obtenus, hors congruence, il n'y a pas besoin d'argumenter plus.
Non mais là tu ne fais pas d'effort. Partant du principe que je raconte n'importe quoi, tu ne cherches pas à comprendre ce dont je parle.Tiel a écrit :
Lien direct vers la vidéo
Je partirais en vrille parce que j'aurais dit le contraire ?!Tiel a écrit :Sérieusement j’ai l’impression que tu pars en vrille, encore une fois on ne pourra jamais déterminer les causes sélectives ou autres de la majeure partie de la variabilité génétique humaine.
Sache que je n'ai même pas dit le contraire.... Pas tout-à-fait.
Je ne cependant pas, à la différence de toi, que l'on soit en mesure d'affirmer comme tu le fais, sans tester la voie que je propose, qu'il soit impossible de déterminer les "causes sélectives ou autres" d'une partie suffisante de la variabilité génétique humaine pour voir si le concept de "race" que je propose, complémentaire à celui de "sous-espèce" est pertinent ou pas.
J'm'interroge a écrit :Pour les chiens en effet, ce sera plus difficile que pour l'Homme car l'on ne dispose sans doute pas d'assez de données sur les sélections réalisées et les caractéristiques recherchées.
Bien je le redis. Excuse moi, mais il me semble que tu me lis mal.Tiel a écrit :Ben non pour les chiens c’est plus facile justement, et tu as le culot de dire que je te lis mal, chez les chiens de race, la diversité génétique est très faible au sein d’une race, et se distribue majoritairement entre les races. Idem pour la variabilité phénotypique définis rigoureusement par les standards strictes pour définir une race. C’est pour cela que la notion de race chez les animaux d’élevage comme chez les chiens a toute sa pertinence.
Il était question de comparer dans une seconde étape : l'arborescence donnée par l'algorithme mettant en évidence les groupes et apparentements de groupes intra-spécifiques sur le critère de la comparaisons des données génotypiques et ou seulement phénotypiques entrées AVEC l'arbre des apparentements des ethnies tel que reconstitué par les sciences humaines. Ethnies humaines donc !
Comment voudrais-tu faire la même chose avec les races canines ? !
Encore une fois, tu me lis pas avec l'attention requise l'ami. Car je sais ce que je dis, le dis clairement et ne dis généralement pas n'importe quoi.
J'm'interroge a écrit :En gros, c'est un arbre phylogénétique complet qui ressortirait et possiblement plus détaillé dans ses ramifications, puisqu'il y apparaîtrait même des ramifications aux sein des espèces, mais sans forcément les caractéristiques précises permettant de les distinguer.... Il faudrait le plus souvent les rechercher ensuite.
Je ne suis pas de cet avis, car ce n'est là qu'un avis que tu exprimes, sachant que toute catégorie ne doit pas nécessairement être fondée sur des caractéristiques précises prises une à une comme je l'ai déjà expliqué pour être objective.Tiel a écrit :Encore une fois tu as au moins vingt trains de retards car ça fait un moment que les généticiens font des arbres pour représentés les proximité génétiques entre les populations. Problème ces arbres ne sont pas des arbres phylogénétiques car factuellement un arbre représentant les distances génétiques comme ceci.
Cache une réalité qui ressemble davantage à ceci.
Voir à ceci.
Plus d’informations sur le lien suivant
Car oui malgré des différences en terme de fréquences alléliques, et adaptatives entre les populations humaines, les flux de gènes régulières entre elles, font qu’on ne parvient à aucune subdivision claire et définitive, permettant de définir un réel arbre phylogénétique ou de réelles sous-espèce ou races.
Je pense que c'est cela que tu ne parviens pas à comprendre et c'est ce qui nous divise.
Sache juste que c'est une question qui a été tranchée en Logique, en Philosophie et en Mathématique.
Quant aux problèmes rencontrés en Biologie (et plus particulièrement en génétique), notamment pour définir une espèce (je parle du problème de porosité entre les espèces qu'évoquait Karlo), ils semblent bien plus plaider en faveur de ce que je dis qu'en faveur du contraire.
Encore faudrait-il pouvoir accepter ce que j'aurais à présenter plus en détail, n'est-ce pas ?Tiel a écrit :Et comme le modèle hypothétique que tu proposes est tellement mal-définie en plus de n’avoir aucun appuie dans une littérature scientifique qui étudie la variabilité génétique au sein de l’espèce humaine depuis plusieurs décennies, je vais en déduire que tu n’as rien à proposer, tant que tu n’apporteras rien de claire et d’un minimum concret.
J'm'interroge a écrit :"Afro-Americain" ne ressortira pas comme groupe, donc comme assimilable à "sous-espèce" ou "races" comme définis par moi. C'est encore une prévision hypothétique que je fais.
La la la !! On dirait Karlo dans ses mauvais jours là !Tiel a écrit :Non car ce qui définis les Afro-Américain c’est un sentiment identitaire et traits culturels communs avec l’idée d’une filiation commune. Preuve que tu ne parviens pas à distinguer ce qui est du domaine biologique, du domaine culturel et social et c’est bien là ton problème et explique probablement en bonne partie le caractère incompréhensible de tes hypothèses.
J'm'interroge a écrit :Et "Afro-Américain" n'est pas ce qu'on peut classiquement appeler une ethnie, non. Je te conseille de demander l'avis d'un anthropologue.
Demande à un anthropologue non idéologue, car la définition plus haut n'est en rien dans la ligne des définitions plus classiques.Tiel a écrit :«In essence, an ethnic group is a named social category of people based on perceptions of shared social experience or ancestry.» PEOPLES, James / BAILEY, Garrick (2014), Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology, 10th, University of Tulsa : Cengage Learning, p.367
C'est plus une définition d' "indentité culutrelle" que d' "ethnie" que tu me cites là.
Mais je nie pas cela ! Je dis qu' "afro-américains" est une "identité culturelle" et non une "ethnie".Tiel a écrit :Bref à moins que tu nies que les Afro-Américains se caractérise par ces perceptions d’expériences sociales et d’ascendances partagés, ce qui reviendrait à être malhonnête, je t’invite à bien te renseigner sur cette question car encore une fois on parle ici de phénomènes culturels et sociale et non pas de biologie.
Dis-tu ethnie parce qu'ils seraient noirs ? Ou mi-café au lait ?
- >>>>>>>>>>>>> Cela ressemble à du racisme l'ami ! Attention !
Rétropédalage parce que je n'aurais pas envisagé la dérive génétique ? ! Mais c'est hyper connu la dérive génétique ! Tu crois sincèrement que tu m'as appris quelque chose à ce sujet ? Bien sûr que je l'envisageais, c'était évident l'ami puisque je parlais d'isolements dûs à des facteurs de nature culturel. Pourquoi j'en parlais à ton avis ?Tiel a écrit :Pour le reste tu navigue entre rétropédalage non-assumé, où tu affirmes avoir toujours tenu compte de la dérive génétique pour malgré tout...
Tu prends un peu trop facilement les autres pour des ignares ou des imbéciles l'ami !
Non, je n'ai rien dit de tel, j'ai suggéré qu'il est hypothétiquement envisageable que les isolements génétiques dû aux facteurs culturels sont non pas forcément prépondérant même chez l'homme par rapport aux isolements génétiques dû aux facteurs naturels et matériels comme la répartition même de l'espèce, aux barrières naturelles etc, mais qu'ils jouent pour une part non négligeable, ce qui devrait être vérifiable si l'on s'en donnait les moyens, mais qui ne le sera probablement jamais tant que les biologistes et généticiens persisteront à CROIRE qu'une catégorie objective devrait toujours permettre de distinguer des individus isolément un à un plutôt que des ensembles d'individus pris dans leur variété.Tiel a écrit :...affirmé la suprématie de tes variations d'origine culturels dans ton modèle hypothétique
Car là est le problème conceptuel de base que je dénonce, celui qui entraîne toute cette incompréhension que je constate.
Excuse moi, mais je t'enmerle !Tiel a écrit :rendant la position que tu défends aussi consistante que de la purée de pomme de terre mixé avec du lait. Je t'invite à te renseigner davantage sur la thématique que tu abordes et à faire de l'ordre dans tes idées et dans dans tes message.
Merci d'avance.
Et sache que ce n'est pas parce que toi-même tu ne sais pas lire, que je m'exprime pas clairement pour qui maîtrise la Logique....
Conclusion :
N'ayant trouvé pour ma part aucune remarque pertinente dans ton dernier post, je décide d'en rester là.
- La réalité est toujours beaucoup plus riche et complexe que ce que l'on peut percevoir, se représenter, concevoir, croire ou comprendre.
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
- ultrafiltre2
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 3329
- Enregistré le : 09 mai15, 02:44
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 08 déc.16, 11:05J'M'Interroge juste pour te dire que faudrait arrêter de voir les mathématiques partout ...(c'est pas que c'est mal c'est juste que pour arriver à ça il faut connaitre tous les sujets à fond or tu n'est pas biologiste )
tu sais que Tiel connait son sujet ...c'est pas en étant désagréable avec lui que tu en saura autant que lui
(pas la peine de me répondre)
m'édite sur ce que dit Rudolf Bkouche là (il est décédé la nuit dernière) justement c'est le sujet de ce que je te dit là
http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/v ... 61eb0733a9
tu sais que Tiel connait son sujet ...c'est pas en étant désagréable avec lui que tu en saura autant que lui
(pas la peine de me répondre)
m'édite sur ce que dit Rudolf Bkouche là (il est décédé la nuit dernière) justement c'est le sujet de ce que je te dit là
http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/v ... 61eb0733a9
the sound - contact the fact l’hyper monde est un infty-simplexe triangulairement scalairisé
...ccnc ...et la lumière fut
...ccnc ...et la lumière fut
- J'm'interroge
- [ Incroyant ]
- [ Incroyant ]
- Messages : 12742
- Enregistré le : 02 sept.13, 23:33
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 08 déc.16, 12:00Ah parce que tu n'en vois pas partout toi ?ultrafiltre2 a écrit :J'M'Interroge juste pour te dire que faudrait arrêter de voir les mathématiques partout ...
Sache que je ne jure pas que par les Maths comme toi l'ami ! Je suis pour ma part plutôt Dialecticien. Mais je suis pour leur donner en tout la place qu'elles méritent, car elles sont remarquables et tu ne vas pas être content : utiles aux sciences.
J'en ai aussi juste un peu assez des formulations nazes de beaucoup de gens qui se disent scientifiques lorsqu'ils parlent de la science qu'ils pensent maîtriser.
Je constate qu'ils sont souvent tout autant dogmatiques que bien des religieux qu'ils moquent, voire parfois même plus.
Ce n'est pas la question, car avec le peu que je sais de la biologie, vois-tu, je peux affirmer que certaines affirmations faites ici par des personnes censées être plus calées que moi dans cette science (et qui le sont sûrement, je ne remets pas exactement cela en question), sont erronées.ultrafiltre2 a écrit :(c'est pas que c'est mal c'est juste que pour arriver à ça il faut connaitre tous les sujets à fond or tu n'est pas biologiste )
Ça, excuse moi l'ami, je le peux à bon droit et en toute logique.
Quant aux choses que j'avance, je peux le faire à bon droit également, car je n'avance rien que des choses hypothétiquement envisageables.
Si si je te réponds.ultrafiltre2 a écrit :tu sais que Tiel connait son sujet ...c'est pas en étant désagréable avec lui que tu en saura autant que lui
(pas la peine de me répondre)
Je ne remets pas en question ces connaissances, mais certaines vérités qu'il en tire à tort.
Je regarderai un autre jour, je n'ai pas beaucoup de temps à moi en ce moment.ultrafiltre2 a écrit :m'édite sur ce que dit Rudolf Bkouche là (il est décédé la nuit dernière) justement c'est le sujet de ce que je te dit là
http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/v ... 61eb0733a9
- La réalité est toujours beaucoup plus riche et complexe que ce que l'on peut percevoir, se représenter, concevoir, croire ou comprendre.
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
- ultrafiltre2
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 3329
- Enregistré le : 09 mai15, 02:44
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 08 déc.16, 12:09JMI tu devrai l'écouter (deux heures c'est pas énorme non plus ...prend sur ton temps de sommeil)
il est décédé la nuit dernière , je suppose que tu n'ira pas à ses obsèques (prévues pour le 12) mais le fait que tu l'écoute cette nuit son esprit rentrera en toi (ça marche pareil) et ça marche mieux avec le manque de sommeil en plus
il est décédé la nuit dernière , je suppose que tu n'ira pas à ses obsèques (prévues pour le 12) mais le fait que tu l'écoute cette nuit son esprit rentrera en toi (ça marche pareil) et ça marche mieux avec le manque de sommeil en plus
the sound - contact the fact l’hyper monde est un infty-simplexe triangulairement scalairisé
...ccnc ...et la lumière fut
...ccnc ...et la lumière fut
- J'm'interroge
- [ Incroyant ]
- [ Incroyant ]
- Messages : 12742
- Enregistré le : 02 sept.13, 23:33
Re: La théorie de l'évolution
Ecrit le 08 déc.16, 12:10Je me lève à 6 heure demain matin et j'ai en responsabilité d'autres personnes. Mais je la regarderai.
- La réalité est toujours beaucoup plus riche et complexe que ce que l'on peut percevoir, se représenter, concevoir, croire ou comprendre.
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit son lot d'expériences vécues.
Sagesse !
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 103 Réponses
- 133324 Vues
-
Dernier message par J'm'interroge
-
- 77 Réponses
- 13030 Vues
-
Dernier message par lionel
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité